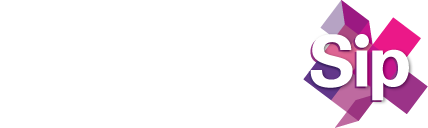L’avis de la commission des affaires sociales (CAS) du Sénat est rendu le 10 février 2010.
D’emblée on peut apprécier la qualité du travail qui rend compte de réalités médicales, thérapeutiques et éthiques. La raison semble enfin l’emporter sur une frénésie législative à orientation sécuritaire dénuée de toute perspective réaliste. Le sénateur, Nicolas About, médecin, est porteur auprès de ses confrères législateurs des valeurs et du réalisme des pratiques médicales.
La présentation de l’injonction de soins reprend son histoire depuis sa naissance par la loi du
18 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs et ses trois évolutions successives avec la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et enfin, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette présentation souligne l’intérêt de l’injonction de soins quand elle est appliquée avec discernement.
La complexité de l’obtention du discernement tient compte des contraintes qui peuvent entrer en jeu en milieu pénitentiaire (remises de peines) et qui nécessite un équilibre entre justice et soins. Il est rappelé que la décision du magistrat d’ordonner une injonction de soins ne peut s’appuyer que sur une expertise psychiatrique la recommandant.
Exposant la fonction du médecin coordonnateur, le rapporteur souligne ce que disent de nombreux professionnels mais aussi souvent députés et sénateurs (toutes couleurs politiques confondues) qu’il conviendrait de rendre opérationnel ce qui existe déjà plutôt que de réformer à nouveau : « Conciliant démarche thérapeutique et impératifs de sécurité, la procédure de l’injonction de soins demande d’abord à être renforcée par le recrutement de médecins coordonnateurs avant que d’être réformée. Les attentes sociales en ce domaine se sont néanmoins accrues, ce qui entraîne des demandes nouvelles dont il convient de mesurer le bien-fondé » (p.12).
Conscient d’une « inquiétude sociale légitime » et « la complexité des émotions suscitées par l’image du fou criminel », le sénateur considère qu’il convient de rester mesurer dans l’appréciation des soins adéquats à apporter notamment en prison car demande-t-il : « La prison peut-elle être un lieu de guérison ? » (p.13). Renforcer les possibilités de soins en prison tout en étant souhaitable ne doit pas faire oublier les alternatives à l’incarcération : « Parallèlement au renforcement des moyens médicaux en prison, il faut donc continuer à réfléchir aux alternatives à l’incarcération pour les personnes atteintes de troubles mentaux » (p.14).
Si la préoccupation de limiter la récidive est un objectif légitime, il convient « d’éviter toute confusion et ne pas assigner à la médecine un rôle qui ne peut être le sien. Soigner n’est pas la même chose qu’empêcher de nuire » (souligné par moi +++ ; p.15).
Dans le projet de loi, la CAS relève une attention disproportionnée accordée au traitement par
antiandrogènes (la mal nommée castration chimique dont l’appellation serait pour le rapporteur l’apanage des urologues) et dont les indications restent limitées et ne rencontrent pas encore un consensus médical. Il est à noter un argument intéressant. Inclure dans la loi un traitement spécifique est très critiqué par les professionnels. N. About rappelle que l’introduction dans le code de la santé publique des traitements inhibiteurs de la libido suite à la loi de 2005 était motivée par l’absence d’AMM alors donnée à ces traitements. Il fallait pouvoir autoriser les médecins à prescrire les antiandrogènes dans une indication non encore légalement prévue.
Depuis l’AMM a été obtenue. L’inscription dans la loi est donc devenue inutile. Il convient de ne plus désigner plus spécialement dans la loi un traitement spécifique ce qui reviendrait à « instrumentaliser la médecine » (p.18).
L’analyse des articles révèle des points importants.
L’article 5 bis prévoit que des « expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires » peuvent figurer dans un répertoire (pour ne pas dire fichier) des données médicales versées au dossier judiciaire d’un condamné. La référence « examens » peut faire craindre que les données médicales collectées dans une démarche thérapeutique pourraient être versées au dossier. N. About demande la suppression du mot « examens » en l’argumentant de manière concise et explicite : son maintien serait « susceptible de concerner des documents relatifs au traitement dont le juge n’a pas à connaître ».
L’article 5 ter est redoutable puisqu’il focalise sur le traitement inhibiteur de la libido. La CAS propose clairement que cette référence soit supprimée : « Votre commission soutient les modifications adoptées par la commission des lois. La focalisation sur le traitement « inhibiteur de la libido » ou antihormonal lui paraît cependant parfaitement inadapté à la réalité de la médecine. Ces formes de traitement n’en sont qu’une parmi d’autres et le médecin doit être libre de le prescrire ou non dans le cadre d’une thérapie d’ensemble qu’il détermine avec le malade. Elle vous propose donc, par voie d’amendement, de supprimer les références à ce traitement, tant aux différents stades de la procédure judiciaire (expertises psychiatriques et prononcé de l’injonction) que dans le code de la santé publique » (p.23).
L’avis se termine sur les débats des travaux en commission. On y remarquera qu’après que la commission des lois se soit efforcée de « réduire la confusion entre le rôle du juge et du médecin et de préserver le secret médical », la CAS a renforcé cette orientation en amendant les articles 5 bis et 5 ter, notamment en supprimant toute référence au traitement antiandrogènes car « C’est en effet à cette condition que justice et santé pourront continuer à ouvrer ensemble et sans ambiguïté pour le soin et la protection des personnes ». A noter une petite « coquille » (p.23), les UMD sont nommées « unités pour malades dangereux » (au lieu de difficiles). Difficile d’évacuer la dangerosité… Et également, ce n’est pas la loi du 12 décembre 2005 qui a permis au juge une HO après ordonnance d’irresponsabilité mais la loi du 25 février 2008 (p.23).
La fin de l’avis résume de la manière suivante les travaux de la CAS :
« A l’article 5 bis (répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires), elle a adopté un amendement de précision afin de lever toute ambiguïté sur la nature des documents médicaux susceptibles de figurer dans le répertoire.
A l’article 5 ter (injonction de soins et surveillance judiciaire), elle a adopté neuf amendements tendant à effectuer plusieurs coordinations et supprimer :
– la référence au traitement antihormonal ou « inhibiteur de la libido » dans l’injonction de soins que peut prononcer le juge afin d’en réserver le choix au médecin traitant ;
– la mention expresse du traitement antihormonal car il n’y a pas lieu de préciser dans la loi les types de traitement pouvant être prescrits par un médecin traitant au cours d’une incarcération ;
– l’obligation pour les experts médicaux de se prononcer sur un type de traitement en particulier, en l’occurrence le traitement antihormonal, leur mission étant de se prononcer sur le contenu de l’injonction de soins, c’est-à dire sur l’ensemble des traitements susceptibles d’être prescrits ;
– la référence explicite aux traitements antihormonaux dans le code de la santé publique.
Elle a enfin donné un avis favorable à l’adoption de ces deux articles ainsi modifiés ».
Maintenant, il convient d’espérer que la politique politicienne, lors de la discussion finale de la loi, ne tendra pas à aggraver le risque de récidive législative faussement sécuritaire, alors que le projet annoncé est d’amoindrir le risque de récidive…..