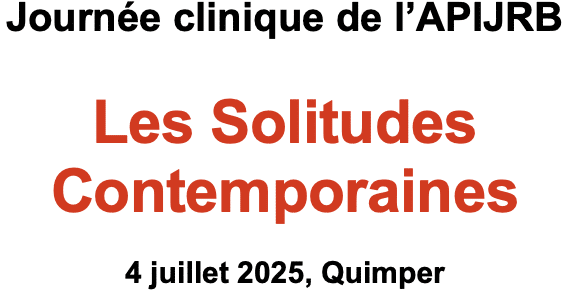RETENTION DE SURETE (URGENCE)
M. le président. – L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Discussion générale
Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. – (Applaudissements à droite et au centre) Je remercie votre commission, son président et son rapporteur, d’avoir saisi toute l’importance de ce texte ambitieux : il s’agit rien de moins que de mieux protéger les Français et d’aider les condamnés, dans le respect de nos principes fondamentaux. (« Très bien ! » à droite) J’entends dire que ce texte serait de circonstance, uniquement lié à l’actualité. La lutte contre la récidive est pourtant une préoccupation constante des gouvernements depuis dix ans au moins : le fichier national des empreintes génétiques, instauré en 1998 par Mme Guigou, le fichier national des agresseurs sexuels, créé en 2004, le bracelet électronique, prévu en 2005, les traitements antihormonaux, autorisés en 2005, le renforcement de l’injonction de soins, avec la loi du 10 août dernier, autant de moyens pour prévenir la récidive et réduire la dangerosité des délinquants. Depuis 2005, trois rapports de M. Burgelin, de M. Garraud et de vos collègues Goujon et Charles Gautier ont confirmé la nécessité de mieux protéger la société contre les délinquants dangereux en installant des centres fermés de protection sociale ou des unités hospitalières de long séjour.
Le sujet n’est donc pas dicté par l’actualité ! Du reste, pourquoi faudrait-il s’interdire d’agir face aux drames de l’actualité ? Il est de notre responsabilité d’améliorer la loi, la sécurité de tous, et de notre devoir d’empêcher de nouveaux crimes ! Or, les actions réalisées depuis dix ans ne suffisent pas. Des crimes atroces, barbares ont été commis par des criminels qui avaient été déjà condamnés et dont on savait qu’ils recommenceraient, qu’on savait très dangereux ! Les Français s’en sont émus : pourquoi les criminels encore sujets à des pulsions, et qui refusent de se soigner, sont – ils remis en liberté ? Pourquoi attendre de nouveaux crimes ? Faut-il continuer de fermer les yeux, réfléchir encore dix ans ? Faut-il se contenter de compatir quand des enfants comme Matthias ou Enis sont victimes de la violence, ou seulement saluer le courage avec lequel des jeunes filles comme Anne-Lorraine Schmitt résistent à leur agresseur avant de trouver la mort ?
Doit-on ne rien faire sous prétexte de ne pas céder à la pression de l’actualité ? Ce n’est pas ma conception de l’engagement politique. Nous n’avons plus le droit d’attendre !
Ce texte visait initialement les condamnés pour des meurtres, viols ou actes de torture sur des mineurs âgés de moins de 15 ans. Les députés ont souhaité que les crimes visant tous les mineurs soient concernés : il n’a pas paru souhaitable que la loi fasse une distinction entre un crime commis sur un enfant de 13 ou de 16 ans. Les députés ont également voulu que la loi concerne les crimes commis sur une personne majeure avec certaines circonstances aggravantes. Dans ce cas précis, ce n’est pas l’âge de la victime qui importe. C’est la gravité des faits eux-mêmes qui témoigne de la dangerosité de l’auteur.
Comment pourrait-on nier la dangerosité du criminel pervers qui torture les victimes qu’il viole ? Votre commission a approuvé cette nouvelle orientation, je m’en réjouis.
Sur proposition du Gouvernement, le dispositif transitoire a été étendu aux condamnés qui sont actuellement incarcérés pour avoir commis une pluralité de crimes. Cela vise les tueurs et violeurs en série. Après l’entrée en vigueur de la loi, il faudra que la cour d’assises prévoie l’éventualité d’une rétention de sûreté en fin de peine. C’est le principe du texte.
Mais d’ici là, comment prendre en charge les détenus particulièrement dangereux qui vont être libérés dans les jours, semaines, mois et années à venir ? Personne n’a intérêt à ce que des criminels reconnus particulièrement dangereux soient libérés ! Commettre plusieurs crimes, c’est un signe évident d’extrême dangerosité. Francis Heaulme ou Pierre Bodein, par exemple : avant de commettre les faits qui leur ont valu une condamnation à perpétuité, ils avaient tous deux été condamnés pour plusieurs viols ou meurtres. On aurait pu réagir avant !
On ne peut pas laisser libérer des criminels comme ceux-là après l’entrée en vigueur de la loi. Un bracelet électronique ou une injonction de soins ne seront pas suffisants pour empêcher un nouveau passage à l’acte.
La cour d’assises ne pouvait prévoir la possibilité d’une rétention de sûreté au moment de leur condamnation. Le principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères ne s’applique pourtant pas : la rétention est une mesure de sûreté, ce n’est pas une peine. Elle est prononcée par des juges mais elle ne repose pas sur la culpabilité de la personne, pas plus qu’elle ne sanctionne une faute : elle vise à prévenir la récidive et repose sur la dangerosité de condamnés pour faits graves. C’est une mesure préventive qui répond aux exigences constitutionnelles.
Nous devons traiter de la même façon deux criminels jugés pareillement dangereux : la date de leur condamnation ne saurait justifier une différence de traitement. Les députés, en conséquence, ont modifié la rédaction initiale. Je sais, monsieur le rapporteur, que nous n’avons pas la même lecture du texte, je connais votre souci de renforcer les conditions de placement en rétention de sûreté pour les personnes déjà condamnées. Cependant, nous ne saurions reporter l’application des mesures que nous jugeons aujourd’hui nécessaire à la protection des Français.
Ce texte s’est élargi, certains accusent le Gouvernement d’aller trop loin.
Cette évolution était pourtant nécessaire, elle va dans le sens d’une plus grande protection des Français et elle renforce la prise en charge des criminels particulièrement dangereux.
Il comporte d’abord des mesures de sûreté pour les criminels particulièrement dangereux : ils seront, en fin de peine, pris en charge dans un centre socio-médico-judiciaire. Le jour de la condamnation, le condamné sera averti par le président de la cour d’assises qu’il pourra être soumis à un examen de sa dangerosité et, le cas échéant, placé en rétention de sûreté en fin de peine.
Un an avant la fin de peine, le condamné sera soumis à un examen de sa dangerosité. Si la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté estime que le condamné demeure dangereux, qu’il y a un risque de récidive, que les mesures de contrôle sont insuffisantes et qu’il faudra placer le condamné en rétention de sûreté, elle demandera au procureur général de saisir une commission régionale composée de magistrats de la cour d’appel.
Au moins trois mois avant la date de libération, cette commission régionale rendra une décision motivée après débat contradictoire sur le placement en rétention de sûreté. Cette mesure sera valable un an, elle sera renouvelable, mais elle pourra aussi prendre fin à tout moment.
La personne retenue sera placée dans un centre socio-médico-judiciaire placé sous la tutelle des ministères de la justice et de la santé.
Elle bénéficiera, de façon permanente, d’une prise en charge médicale et sociale. S’agissant de personnes atteintes de troubles extrêmement graves et profonds de la personnalité, les soins comporteront une dimension criminologique. La situation sera réexaminée chaque année.
Trois hypothèses sont à distinguer. Les condamnés pour lesquels une rétention de sûreté a été envisagée par la cour d’assises le jour de leur condamnation pourront être placés dans le centre fermé à la fin de leur peine s’ils présentent encore une dangerosité telle que leur remise en liberté, même surveillée, n’est pas possible. Les tueurs et les violeurs en série actuellement incarcérés pourront aussi être placés en rétention de sûreté à la fin de leur peine. Les cours d’assises n’ont certes pu prévoir un examen de leur dangerosité, mais celle-ci résulte des condamnations prononcées contre eux : il fallait prévoir un dispositif transitoire. Les autres condamnés et ceux qui sont actuellement incarcérés pourront être placés sous surveillance judiciaire après la fin de leur peine et se voir notamment imposer un bracelet électronique mobile et un suivi médical. En cas de manquements traduisant un regain de dangerosité, ils pourront être placés en rétention de sûreté.
J’en viens au deuxième volet du projet de loi relatif aux irresponsables pénaux en raison d’un trouble mental. La procédure ne s’achèvera plus pour eux par la notification d’une ordonnance de non-lieu. Si le juge d’instruction conclut à une irresponsabilité pénale, la décision pourra être précédée d’un débat sur les éléments à charge et l’état mental de l’auteur au moment des faits, et une audience, en principe publique, se tiendra devant la chambre de l’instruction, procédure qui n’est actuellement prévue qu’en appel, pour contester la décision prise par le juge d’instruction, comme cela a été le cas lors de l’appel du non-lieu rendu dans l’affaire du meurtre des infirmières de Pau.
Le non-lieu, la relaxe ou l’acquittement seront remplacés par des décisions d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, inscrites, comme cela est normal dès lors que la personne est reconnue comme l’auteur du crime ou du délit, au casier judiciaire. L’Assemblée nationale a souhaité conférer aux juridictions la faculté, partagée avec le préfet, d’un placement d’office en hôpital psychiatrique. Elles pourront également soumettre la personne reconnue irresponsable à des mesures de sûreté, applicables dès l’hospitalisation aux permissions de sorties, destinées à éviter un nouveau passage à l’acte -interdiction de détenir une arme, de se rendre dans certains lieux, de rencontrer les victimes…
Enfin, si c’est la chambre de l’instruction qui déclare la personne irresponsable, elle renverra l’affaire devant le tribunal correctionnel à la requête des victimes pour statuer sur leurs demandes de dommages et intérêts. Afin de simplifier leurs démarches, le juge délégué aux victimes aura la charge, dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles, de cette formation à juge unique.
Troisième volet : les nouvelles dispositions destinées à améliorer la prise en charge des détenus nécessitant des soins. Dans le prolongement de la loi du 10 août 2007, le détenu qui refusera des soins en détention pourra se voir retirer toutes ses remises de peine, le refus de soins étant désormais assimilé à une mauvaise conduite. Pour assurer un meilleur suivi, l’échange d’information entre le médecin intervenant en milieu carcéral et le médecin qui suivra le détenu à sa sortie de prison sera amélioré. De même, les soignants devront, afin d’assurer la sécurité des personnels intervenant en milieu pénitentiaire et celle des autres détenus, signaler au chef d’établissement les risques pour la sécurité des personnes dont ils ont connaissance. Ces dispositions, qui ne violent en rien le secret médical, ne font que traduire l’obligation qui pèse déjà sur tous les professionnels et doivent éviter que leur responsabilité pénale ne soit engagée du chef de non assistance à personne en danger.
C’est donc un texte d’envergure, équilibré et réfléchi, fait pour concilier la sécurité des Français et le respect des libertés essentielles, que vous soumet le Gouvernement. Je souhaite que notre débat soit constructif et dépasse les clivages politiques. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois. – Ce texte s’insère selon moi dans la suite de la loi récente instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté et dans la préparation de la grande loi pénitentiaire annoncée, que nous appelons tous de nos voeux.
L’univers carcéral touche de trop près la condition humaine, il a fait l’objet de trop de rapports unanimement accablants -le président Hyest ne me contredira pas- pour que nous versions dans le manichéisme, sans rechercher le plus large consensus. Ni la souffrance des victimes ni les efforts considérables des personnels de l’administration pénitentiaire ne doivent être ignorés. Car la corrélation est étroite entre réinsertion, lutte contre la récidive, conditions de travail des personnels, aspirations des victimes et intérêt de la société.
J’entends encore une vice-présidente d’association, elle-même victime d’un violeur en série ayant récidivé dans les trois mois suivants sa libération, exprimer le souhait que le nouveau système permette d’apporter aux condamnés des soins efficaces propres à réduire la récidive au taux le plus faible possible. Je me souviens de son amertume et de sa colère en constatant que la seule activité de son agresseur pendant ses années de détention avait consisté, « à faire de la fonte » c’est-à-dire, dans les mots de l’univers carcéral, à tuer le temps par la pratique de la musculation.
Mes visites dans nos établissements pénitentiaires, dans ceux d’autres pays comme les Pays-Bas, la Belgique et le Canada, les auditions, par la commission des lois, de personnalités éminentes du monde de la justice, de la psychiatrie, de l’université, du secteur associatif, m’ont conduit à une triple conviction sur les carences auxquelles il convient de porter remède au plus vite.
Tout d’abord la proportion de détenus de troubles mentaux, estimée à quelque 20 % de la population carcérale, est considérable. Certes, les cours d’assises ont déclaré ces détenus responsables, mais leur choix ne peut qu’être largement hypothéqué par le peu de réponse qu’une psychiatrie condamnée à l’ambulatoire et dont le nombre de lits en milieu protégé a dramatiquement fondu reste susceptible d’apporter. La prison devient alors trop souvent le seul moyen de protéger la société, au risque de se transformer en plus grand asile psychiatrique de France.
Comment ne pas observer que les déclarations d’irresponsabilité pénale prises en application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal relatif à l’abolition du discernement ont diminué de moitié entre 1987 et 2003, tandis que l’altération du discernement, qui aurait dû constituer une circonstance atténuante en vertu de l’alinéa 2 du même article, se transformait dans les faits en circonstance aggravante ?
La prison est-elle le lieu idoine pour soigner des malades mentaux ?
D’autant que si des progrès remarquables ont été accomplis pour les soins somatiques, il est loin d’en être de même pour les soins psychiatriques. Comment, dans ces conditions, espérer une évolution favorable de l’éventuelle dangerosité du détenu à la fin de sa peine ?
S’il est vrai que la rétention de sûreté vise essentiellement les personnes les plus dangereuses atteintes de troubles du comportement et qu’une majorité de psychiatres et de criminologues tendent à ranger parmi les psychopathes, reste que tous les malades souffrant de troubles psychiatriques sérieux et durables devraient pouvoir être orientés vers une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) le temps nécessaire à leur traitement, ainsi que nous vous le proposerons par amendement. Quant à la distinction entre abolition et altération du discernement prévue par l’article L. 122-1 du code pénal, il conviendrait d’urgence de la clarifier.
Soins et traitements devraient être dispensés dès le début de l’incarcération et non quelques mois avant la date prévue pour la libération.
M. Robert Badinter. – Très bien !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. – De même, la formation ou l’exercice d’une activité, qui facilitent largement la réinsertion, mériteraient d’être mieux encouragés et accompagnés.
C’est ici qu’une évaluation bien conduite, dont mon récent voyage au Québec m’a permis de mesurer les effets positifs, prend tout son sens. Réalisée par une équipe pluridisciplinaire à la suite d’une observation de longue durée, elle permettrait d’élaborer un parcours d’exécution de la peine correspondant à une véritable stratégie individualisée de lutte contre la récidive. Nous vous proposerons plusieurs amendements en ce sens, visant pour l’heure les personnes pouvant être soumises à la rétention de sûreté mais qui mériteraient d’être généralisées par le projet de loi pénitentiaire.
Sur la rétention de sûreté proprement dite, il convient de lever quelques ambiguïtés quant à la position de votre commission. Elle considère que cette initiative était nécessaire et met fin à un vide juridique dont les conséquences pouvaient s’avérer tragiques pour nos concitoyens. Dans chaque prison que je visite, je demande aux personnels de direction et de surveillance comme aux personnels médicaux s’ils comptent dans leur établissement des cas dont la libération en fin de peine leur paraîtrait exposer la société à un risque majeur. La réponse est toujours positive même s’il elle ne concerne qu’un nombre très faible d’individus. Certains d’entre eux, j’ai pu le constater, loin d’éprouver remords ou compassion à l’égard de leurs victimes, se plaisaient à renouveler le récit du plaisir pris à leur crime, affirmant leur intention de récidiver dès qu’ils en auraient l’opportunité. C’est avant tout pour eux que la rétention de sûreté est nécessaire et l’on peut espérer qu’elle les convaincra de se soigner sachant qu’un refus de soin pourra les priver d’une totale liberté.
Bien évidemment, la rétention de sûreté doit rester l’ultime solution. Elle ne doit pas nous faire oublier les défaillances de notre système et donc notre part de responsabilité dans les tragédies que nous avons eu à déplorer. La désastreuse affaire Evrard ne témoigne-t-elle pas d’une carence de la psychiatrie en milieu carcéral ? Lorsque j’ai visité le centre pénitentiaire de Caen, le responsable du service médico-psychologique régional me confiait qu’en raison du manque de médecins psychiatres, les demandes d’entretien individuel pouvaient attendre plus de douze mois. Carence, aussi, dans l’exécution des lois puisque le placement sous surveillance électronique prévu par la loi de décembre 2005 n’a pu être mis en oeuvre faute du texte d’application qui n’est venu qu’en août 2007, lors de la libération du détenu. Carence, enfin, dans le fonctionnement du service public, puisque l’adresse laissée par une personne dont nul n’ignorait la dangerosité aurait méritée d’être contrôlée.
Votre commission des lois s’est également longuement interrogée sur la conformité de la rétention de sûreté tant à la Constitution qu’à la Convention européenne des droits de l’homme. Sur l’application immédiate de cette réforme aux faits et aux condamnations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi, les avis ont été largement partagés. La distinction entre mesure de sûreté et peine, ou plus précisément la distinction entre mesure de sûreté et mesure prise en considération de la personne et présentant le caractère d’une sanction, ne va pas de soi et bien imprudent serait celui qui s’aventurerait à prévoir l’éventuelle décision du Conseil constitutionnel.
De même, l’application de la rétention de sûreté aux criminels les plus dangereux sans que la juridiction de jugement ait pu prévoir expressément dans sa décision le réexamen de la situation de la personne pourrait poser problème à la cour de Strasbourg.
La Cour constitutionnelle allemande a, le 5 février 2004, validé la détention-sûreté mais, sans lui manquer de respect, je rappellerai que sa jurisprudence n’a pas plus de portée en France que celle de notre Conseil constitutionnel n’en a en Allemagne.
Sur la seconde préoccupation majeure de ce projet de loi, l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les opinions exprimées lors des auditions ont été plus consensuelles. A l’opposé des craintes exprimées naguère sur le risque de juger les fous, les nouvelles procédures permettent à la juridiction qui constate l’irresponsabilité pénale de se prononcer aussi sur la réalité des charges ainsi que sur les mesures de sûreté indispensables.
Les victimes y trouvent plusieurs motifs de satisfaction. L’irresponsabilité pénale est préférable au non-lieu, à la relaxe ou à l’acquittement. La comparution du mis en examen, la possibilité d’entendre des témoins et d’avoir une véritable audience publique, ainsi que l’action en responsabilité civile sont facilitées. La chambre de l’instruction de la juridiction de jugement pourra se prononcer pour une hospitalisation d’office, comme l’a prévu un amendement de l’Assemblée nationale. En cas d’urgence, ce dispositif peut se rapprocher de la judiciarisation de l’hospitalisation d’office réclamée par certains collègues, dont M. Dreyfus-Schmidt.
Votre commission attend de ce texte qu’il définisse les orientations d’une réforme ambitieuse de notre système pénitentiaire. Je ne sais si la rétention de sûreté constitue, comme nous l’a confié un éminent universitaire, une révolution juridique, mais je souhaite que la loi pénitentiaire soit la révolution à laquelle nous aspirons. (Murmures ironiques à gauche)
M. Robert Bret. – C’est l’Arlésienne !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. – Sans doute la rétention de sûreté perdra-t-elle alors beaucoup de son utilité.
Je vous propose donc d’adopter ce texte amélioré par les amendements que nous présenterons. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. – Ce texte comporte une dimension sanitaire et sociale qui me conduit à intervenir. Jean-René Lecerf nous a livré une présentation brillante et exhaustive de ses enjeux et dispositions. Je limiterai donc mon propos aux interrogations que suscite la mise en oeuvre du nouveau dispositif de rétention de sûreté et des injonctions de soins.
La création de la rétention de sûreté, justifiée pour un nombre limité de cas pathologiques, constitue le constat d’échec de la prise en charge psychiatrique en milieu carcéral. (Mme Borvo Cohen-Seat approuve) Le développement des soins ambulatoires au détriment des hospitalisations de longue durée a, en France comme dans la plupart des pays occidentaux, contribué à accroître la population de malades mentaux et de psychopathes dans les prisons. Or, les moyens n’ont pas été mis en oeuvre pour traiter ces personnes et favoriser leur réinsertion.
La rétention de sûreté concernera chaque année une dizaine d’individus jugés incapables de vivre en société avec les dispositifs de surveillance et de soins existants. Je souhaite m’assurer que toutes les garanties seront prises pour ne pas appliquer cette mesure à des personnes qui relèveraient, compte tenu de leur état psychiatrique, de l’hospitalisation. La dangerosité criminologique ne doit pas être confondue avec la dangerosité psychiatrique, ni les malades mentaux avec les criminels. La corrélation entre l’existence de troubles mentaux et le passage à l’acte criminel, bien que non négligeable, est très faible, de l’ordre de 5 % pour les homicides.
Cela nous amène au problème de l’expertise qui présidera à la décision d’appliquer la rétention de sûreté. L’évaluation de la dangerosité est difficile, et le nombre d’experts psychiatres insuffisant : huit cents sont inscrits près des cours d’appel et de la Cour de cassation, avec d’importantes disparités géographiques. Du fait de cette pénurie, ces experts ne consacrent plus qu’une infime partie de leur temps aux consultations cliniques et deviennent en quelque sorte des « experts professionnels », ce qui ne me semble pas souhaitable. Pour éviter cet écueil, est-il prévu de rendre l’activité d’expertise financièrement plus attractive, notamment pour les psychiatres libéraux, et professionnellement mieux reconnue ?
Sur la question des droits accordés aux personnes en rétention de sûreté, j’avoue, madame le ministre, ne pas avoir bien compris vos intentions. Certes, les personnes dont l’état de dangerosité criminologique a été reconnu doivent être empêchées de nuire. Pour autant, ayant purgé leur peine, elles ne doivent plus être considérées comme des détenus. J’estime singulier que l’exposé des motifs affirme que, « pendant cette rétention, la personne bénéficiera de droits similaires à ceux des détenus ». Ne serait-il pas au contraire légitime qu’elle dispose de droits plus étendus, notamment pour les visites et les activités ? Pour cette même raison, les centres socio-médico-judiciaires doivent être créés hors des prisons et des hôpitaux psychiatriques. Il s’agit d’inventer un troisième type de lieu et de prise en charge, qui poursuive le triple objectif de protéger la société du risque de passage à l’acte criminel, de soigner, mais aussi de permettre la réinsertion. Sans être angélique, j’ai sans doute gardé quelques réflexes du médecin que je fus… Madame le ministre, pouvez-vous nous présenter les moyens qui seront mis en oeuvre, dans le cadre de la rétention de sûreté, pour favoriser une réinsertion sociale ?
Pour ce qui est de l’injonction de soins, ce dispositif, souvent essentiel à la réinsertion sociale, a été encouragé par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive, qui l’a étendu à d’autres mesures que le seul suivi socio-judiciaire. Or le nombre insuffisant de médecins coordonnateurs rapporté au nombre croissant de personnes concernées rend sa mise en oeuvre problématique. Le recrutement de ces professionnels se heurte, ici encore, au caractère peu attractif de la rémunération et à une évolution de la démographie médicale défavorable. La loi de 2007 prévoyait que l’effectif des médecins coordonnateurs soit multiplié par trois d’ici le 1er mars 2008, pour atteindre quatre cent cinquante médecins. Madame le ministre, pouvez-vous nous indiquer l’effectif actuel des médecins coordinateurs ? Leur rémunération a-t-elle été revalorisée, comme l’a annoncé la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé ?
Le recrutement de médecins coordonnateurs et de psychiatres pour intervenir auprès des détenus et, bientôt, des personnes en rétention de sûreté, souffre également de l’évolution démographique de cette profession. Il manque huit cent trente psychiatres dans le secteur public hospitalier, auquel revient la prise en charge des détenus. Selon le rapport de notre collègue Jean-Marc Juilhard, la situation va empirer et près de deux mille postes de psychiatres hospitaliers seront vacants à l’horizon 2020. En outre, ces professionnels sont mal répartis sur le territoire national et de véritables « déserts psychiatriques » apparaissent en milieu rural, dans les départements situés au nord de la Loire, dans les banlieues sensibles et en outre-mer.
Certes, l’augmentation du numerus clausus permettra de rétablir cette situation, mais des mesures correctrices s’imposent dès maintenant. Il faut ouvrir la prise en charge de ces personnes à des psychiatres libéraux -pour lesquels la pénurie est moins sensible car la rémunération y est supérieure- ainsi qu’à des équipes pluridisciplinaires. Des psychologues agréés devraient être encouragés à intervenir dans les établissements pénitentiaires, les nouveaux centres de rétention socio-médico-judiciaire et pour le suivi des injonctions de soins. Cette dernière possibilité a été ouverte par la loi du 12 décembre 2005 relative à la récidive des infractions pénales, mais le décret d’application définissant les conditions de diplôme n’a, à ce jour, toujours pas été pris. Je suis très favorable à la proposition de la commission des lois de conserver la possibilité, pour un psychologue, de mettre en oeuvre une injonction de soins. Le ministère de la santé doit prendre les mesures réglementaires nécessaires à la définition des formations autorisées pour la prise en charge des délinquants sexuels. Et je soutiens résolument la proposition de maintenir le droit, pour des médecins ayant reçu une formation adaptée, d’être recrutés comme médecins coordonnateurs des injonctions de soins afin de pallier la pénurie de psychiatres.
Madame le ministre, sans doute les précisions que vous m’apporterez lèveront-elles les quelques réticences que j’ai pu laisser transparaître, mais sur le fond je vous soutiendrai pour le vote de ce texte. (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Raymonde Le Texier. – C’était très bien, sauf la dernière phrase !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. – Après avis de la commission des lois, je souhaiterais, pour la clarté de nos débats, dissocier de l’examen de l’article premier les deux amendements de suppression nos 52 et 64. (Assentiment)
M. Hugues Portelli. – (Applaudissements à droite) Ce projet de loi traite d’un sujet douloureux sur lequel le pays attend des réponses claires et responsables. Les délinquants très dangereux dont nous devons protéger la société sont aussi des personnes qui ont droit à la garantie de leurs libertés fondamentales, mais ils ne doivent pas non plus utiliser ces droits pour les retourner contre la société, notamment contre les êtres les plus fragiles.
Ce texte courageux, fruit d’un vrai travail d’écoute fait justice de certaines critiques injurieuses, indignes du Parlement. Sachez, madame la ministre, que vous avez le soutien du groupe UMP du Sénat.
Je félicite aussi notre rapporteur, M. Lecerf, pour son travail de qualité, pour l’intérêt des auditions auxquelles il a procédé, pour sa rigueur et son honnêteté intellectuelles.
Admettre qu’une personne est inamendable : l’idée est choquante dans une société démocratique et humaniste, et pourtant, c’est la réalité pour une infime minorité, car il arrive que des hommes ne soient pas réinsérables dans notre société même après une longue peine. C’est un constat mais il faut demeurer très prudent, et très respectueux des droits humains dans la réponse à y apporter. Ne rien faire et nier cette réalité serait contraire à tout véritable humanisme.
Ce projet de loi comprend deux volets principaux. Le premier, relatif à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, avait été décrié avant même d’être élaboré. Je constate que le texte du Gouvernement fait maintenant l’objet d’un large consensus (protestations sur les bancs socialistes) et je m’en réjouis.
Le second est relatif à la rétention de sûreté et concerne les personnes condamnées à de lourdes peines, le plus souvent à la suite d’infractions sexuelles et susceptibles de récidives. C’est sur lui que le débat s’est déplacé. Ces délinquants très dangereux nécessitent un traitement particulier, protecteur de la société et de ses éléments les plus fragiles, et le projet de loi y répond en créant, sur le modèle du droit allemand…
Mme Raymonde Le Texier. – Le droit allemand des années trente !
M. Hugues Portelli. – … les centres de rétention et une nouvelle mesure de sûreté, la rétention de sûreté. Sur le centre de rétention, nous avons proposé un amendement afin de mieux définir ses missions et de bien distinguer la mesure de sûreté de la peine. Je ne comprends pas que l’on puisse assimiler le traitement médical ou psychologique d’une personne à une peine. D’ailleurs, la Cour constitutionnelle allemande…
M. Michel Dreyfus-Schmidt. – Encore !
M. Hugues Portelli. – … dans une décision de février 2004 relative à la détention-sûreté a rappelé qu’elle vise des objectifs différents de ceux de la peine de prison. Selon le juge suprême allemand, « la sanction consiste dans le fait de punir en réaction à un comportement coupable et sert à réparer la faute pénale ». En revanche, les mesures de détention-sûreté « servent surtout … à la prévention dans des cas spécifiques, c’est-à-dire à empêcher des délits ou crimes dans l’avenir en exerçant une influence sur l’auteur ». Et la Cour conclut que « La détention à titre de mesure de sûreté n’a pas pour but, contrairement à la peine, de faire expier une faute commise, mais de protéger l’ordre public contre l’auteur. Ce n’est pas la faute pénale mais la dangerosité dont l’auteur a fait preuve qui détermine le prononcé, l’organisation et la durée de la mesure ».
On rétorquera que l’autorité de chose jugée des décisions de la Cour constitutionnelle allemande ne franchit pas les frontières, mais il est néanmoins utile de connaître l’interprétation du juge constitutionnel compétent à propos d’une loi dont le législateur français s’est largement inspiré. Nous ne pouvons pas non plus ignorer les liens entre les cours constitutionnelles d’Europe et le développement d’une base jurisprudentielle commune, notamment en matière de droits fondamentaux.
Le Conseil constitutionnel français a rendu une décision le 8 décembre 2005 sur la loi relative à la récidive des infractions pénales, qui rejoint l’appréciation de son homologue allema