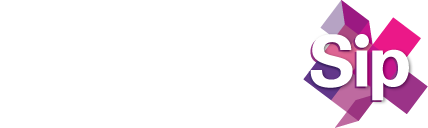Recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles
Conférence de consensus
« L’expertise judiciaire civile »
Recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles
Version longue
15-16 novembre 2007
Cour de cassation, Paris
Sommaire :
PRESENTATION DE LA CONFERENCE :
Les bonnes pratiques judiciaires : définitions et remarques liminaires
SUR LA NECESSITE DU RECOURS A L’EXPERTISE
Question 1°-1 : Quels sont factuellement les grands types d’expertise ?
Question 3° : Quelle est l’incidence du coût de l’expertise sur la décision d’y recourir ?
Question 2°-1 : Peut-on, et si oui comment, choisir l’expert hors liste ?
Question 6° : Comment apprécier l’indépendance de l’expert ?
Question 6°-1 : Faut-il lui demander de faire une déclaration d’indépendance ?
Question 6°-2 : Si oui, sous quelle forme ?
Question 6°-4 : Quelle est la place respective des experts judiciaires et des experts de parties ?
SUR LA DEFINITION DE LA MISSION D’EXPERTISE
Question 1°-2 : Les parties peuvent-elles contractualiser la mission à soumettre au juge ?
Question 2°-1 : Dans quels cas le juge ne doit-il pas utiliser une mission type ?
Question 2°-2 : Faut-il modéliser les missions-types ?
Question 3°-1 : La mission peut-elle préciser la méthodologie que devra employer l’expert ?
SUR LES DELAIS ET LE COUT DE L’EXPERTISE
Question 1°-1 : Comment fixer le délai de l’expertise ?
Question 3° : Comment, et quand, le juge procède-t-il au contrôle des délais ?
Question 5° : Dans quel cas le juge doit-il lancer un appel d’offres sur le coût de l’expertise ?
AVANT-PROPOS
La Cour de cassation et la Conférence des premiers présidents de cour d’appel indiquent que les conclusions et recommandations présentées dans ce document ont été rédigées par le jury de la Conférence de consensus en toute indépendance. Elles sont proposées aux juges, sans valeur normative, pour contribuer à une meilleure qualité de la justice.
La présente « version longue » des recommandations fait l’objet d’une « version courte » qui en est la synthèse.
La synthèse du jury
Présentation du document
Les réponses aux questions posées par le promoteur à l’attention du juge constituent la première partie du document. Elles sont présentées dans l’ordre proposé par le promoteur qui les a ordonnées en quatre groupes sur :
– Sur la nécessité du recours à l’expertise,
– Sur le choix de l’expert,
– Sur la définition de la mission de l’expertise,
– Sur les délais et le coût de l’expertise.
Pour chaque groupe de questions, à l’exception du troisième, une présentation synthétique, renvoyant aux documents de référence, précède les recommandations elles aussi synthétiques.
Dans de nombreux cas, il est apparu dans les groupes de travail que des mesures d’organisation et d’administration judiciaires étaient utiles voire nécessaires pour faciliter les bonnes pratiques retenues en réponses aux questions : le jury a fait sienne cette volonté de ne pas limiter ses recommandations au cadre existant.
Ce sont principalement des regroupements de moyens dépendant de l’administration judiciaire, dans les juridictions, les cours d’appel, ou à des niveaux géographiques plus larges, sur lesquelles le juge pourrait s’appuyer. Citons à titre d’exemple une référence fréquente au « service du contrôle des expertises» de la cour d’appel ou des grandes juridictions.
Ce sont aussi des recommandations ou des souhaits adressés aux auxiliaires de justice, voire aux justiciables, tant à titre particulier dans leur pratique du procès, que dans leurs instances représentatives, ordinales ou associatives. Dans certains cas, même, il est apparu utile de sortir du cadre judiciaire pour mobiliser d’autres ressources comme les sociétés savantes ou les instances de normalisation et de qualification : l’expertise en effet n’est pas que judiciaire, elle est aussi une « démarche fréquemment utilisée pour élaborer des avis, des interprétations, des recommandations en vue de prévenir, d’innover, de construire et d’expliquer l’origine des événements ou des catastrophes, d’établir des responsabilités, d’éclairer la résolution des conflits, d’évaluer des dommages, des objets ou des services de toute nature » comme le définit la norme X50-110 et peut donc bénéficier de partage d’expérience ou de moyens avec les autres parties prenantes à l’expertise en général.
Les annexes et références
Afin de ne pas alourdir la présente synthèse, les textes pertinents et les documents de travail sont reproduits en annexe ou cités en référence.
Un point déterminant : s’inscrire dans la durée
Le jury souhaite que ces recommandations aident sans délai les juges, les parties et les acteurs du procès dans leur pratique quotidienne.
Il a conscience que la bonne pratique qu’il décrit est amenée à se modifier au rythme des évolutions culturelles, de l’influence du droit comparé et des possibilités technologiques, ainsi que de ses difficultés d’application.
Les bonnes pratiques judiciaires : définitions et remarques préliminaires :
Les modalités des mesures d’instruction exécutées par un technicien
L’article 232 NCPC en distingue trois :
– la constatation, qui désigne l’acte par lequel le technicien se prononce sur la matérialité de faits qu’il décrit et dont il fait rapport au demandeur (cf. article 249 NCPC) ;
– la consultation, qui désigne l’acte par lequel le technicien énonce un avis sur une question purement technique ou sur une question de l’espèce ne demandant pas d’investigation complexe (cf. article 256 NCPC) ;
– l’expertise, qui désigne l’acte par lequel le technicien énonce un avis sur une question impliquant la mise en œuvre d’investigations complexes demandant au technicien, outre des recherches dans les bases de données accessibles ou l’exploitation de sa propre expérience, des investigations particulières (cf. article 263 NCPC).
Des difficultés sémantiques
Il est courant d’employer le terme « expertise », dans le contexte judiciaire, au sens large de « mesure d’instruction confiée à un technicien », alors que l’expertise n’est que l’une des modalités de ces mesures d’instruction, la plus intensive et souvent la plus coûteuse.
Or, ce glissement sémantique peut être dommageable en ce qu’il conduit la pratique judiciaire à négliger les autres modalités et à recourir trop mécaniquement à l’expertise.
Il est de bonne pratique de bien distinguer les différentes modalités d’instruction confiées à des techniciens et d’utiliser les appellations exactes.
Dans le présent document, le terme d’expertise a été le plus souvent utilisé au sens large.
La référence au « juge »
Dans de nombreux cas, les textes font référence au « juge » : ainsi l’article 153 NCPC, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, dispose que la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge ; ainsi l’article 235 NCPC prévoit que si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Il apparaît donc que « le juge » que mentionnent les textes peut être soit le juge qui a ordonné la mesure d’instruction soit un autre juge, chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
Cette pluralité peut parfois créer difficulté, notamment aux juges eux-mêmes, ou aux parties ou au technicien, qui ignorent qui a pouvoir de statuer aux différents moments de l’exécution de la mesure d’instruction.
Le jury lui-même a souvent été confronté à cette situation. Il en a conclu que toutes les juridictions devraient organiser la fonction du « juge du contrôle » en un service structuré, doté de moyens permanents. Les « juges du contrôle » et les services de la cour d’appel ayant à connaître des experts, devraient travailler en étroite collaboration à toute étape des mesures d’instruction confiées à des techniciens : choix de l’expert, définition des missions, fixation des délais et des coûts, contrôle des opérations, notamment.
SUR LA NECESSITE DU RECOURS A L’EXPERTISE
Ce chapitre, expose, outre les développements nécessaires pour répondre aux questions du premier groupe de travail, des éléments communs aux quatre groupes.
I – Présentation synthétique :
Juger procède d’une fonction régalienne et se présente comme un pouvoir confié au juge en raison de son savoir. Mais le savoir juridique peut être insuffisant et, puisque pour juger il faut comprendre, le savoir technique doit être apporté au juge, par les parties lors de l’établissement des preuves et/ou par le recours au savoir de techniciens. L’histoire montre l’avènement progressif du recours à l’expertise et donc du recours à l’expert.
L’expertise est-elle nécessaire au règlement du litige ? Telle est la question à laquelle le juge devrait répondre à l’occasion du recours à l’expertise. Cependant, l’analyse de la pratique (A) comme celle des raisons de recourir ou non à l’expertise (B) apportent des éclairages contrastés à la réponse qui peut lui être apportée et qui peut être complétée, à la lumière du droit comparé, par l’influence des garanties fondamentales du procès (CEDH), notamment à propos du rôle des parties (C).
A – La pratique :
Recours à l’expertise ou recours au technicien
Quand recourt-on à l’expertise ? Sur quoi porte-t-elle et dans quelle perspective est-elle utilisée ? Est-elle distinguée des procédés voisins ?
Selon les dispositions applicables, la finalité des mesures d’instruction faisant appel à un technicien consiste soit à établir la matérialité de certains éléments de preuve, soit à déterminer l’existence de faits propres à constituer autant de maillons utilisés dans le raisonnement du juge, soit encore à prolonger une première décision du juge en chiffrant ses conséquences, contribuant ainsi à l’achèvement de la décision judiciaire.
La pratique du recours à l’expertise dépasse donc par son ampleur celle qui résulte de la lettre des textes (articles 144, 147 et 263 NCPC) : c’est-à-dire établir la preuve, ou la conservation de faits pour éclairer le juge sur une question factuelle, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Parmi l’éventail des recours aux techniciens prévus par le Code civil, c’est surtout à l’expertise que la pratique recourt, sans respecter la gradation prévue par les textes entre l’enquête, la constatation, la consultation et l’expertise et, a fortiori, sans utiliser les possibilités de transport sur les lieux et de constatation personnelle. Il y a donc une nette distorsion entre la variété des mesures d’instructions disponibles et celle massivement utilisée : l’expertise.
La conférence insiste sur le respect des textes : le principe du recours à une mesure d’instruction doit être limité aux cas dans lesquels celle-ci est non seulement utile, mais nécessaire à la solution du litige.
S’agissant du choix de la mesure d’instruction, un glissement sémantique s’est opéré par rapport aux termes employés dans le nouveau code de procédure civile. Là où les textes envisagent de façon générique un technicien dont l’expert n’est qu’une espèce aux côtés du constatant et du consultant, la pratique utilise le terme « expert » comme synonyme de technicien, ce qui contribue à généraliser le recours à l’expertise au détriment des autres mesures d’instruction.
Il est de bonne pratique d’adapter le choix du technicien au but recherché et notamment à la complexité des investigations envisagées. Il convient aussi, s’agissant du référé probatoire, de vérifier non seulement la légitimité de la mesure demandée mais aussi son objet, c’est-à-dire sa limitation à l’établissement, ou à la conservation, des preuves.
En effet, le recours à l’expertise intervient surtout avant tout procès (60 à 80% des cas). Elle est aussi ordonnée par le juge de la mise en état ou lorsque l’affaire est plaidée. Le jury constate, en l’absence de données statistiques exploitables, qu’il ne dispose pas d’une image fidèle de la répartition des domaines dans lesquels les expertises sont ordonnées. Il résulte cependant d’une enquête partielle que les principaux domaines sont ceux du bâtiment et de la santé.
B – Les raisons de recourir ou non à « l’expertise » :
Le cas général et les exceptions
Le juge est libre de décider de recourir à l’expertise ; ce principe du droit français est également commun à d’autres droits du système romano-germanique, comme le droit italien ou le droit allemand. Cette liberté s’affirme particulièrement au cours de l’instance. Certains éléments contribuent pourtant à dissuader le juge tandis que d’autres au contraire l’incitent ou l’y obligent.
L’obligation qu’a parfois le juge de recourir à l’expertise trouve sa source dans les textes : plutôt qu’une expertise judiciaire, il s’agit d’une expertise légale. Le législateur peut en effet présumer que le juge ne dispose pas des connaissances suffisantes (par exemple en matière de filiation, sauf preuve d’un motif légitime de ne pas y recourir, ou en matière d’action en rescision pour lésion, article 1678 C. civ.).
La dissuasion découle de considérations techniques ou financières.
S’agissant des considérations techniques, le juge refuse de recourir à l’expertise dans diverses hypothèses. Il peut d’abord se considérer assez éclairé (par exemple parce qu’ont été claires et non véritablement remises en cause les « expertises amiables », c’est-à-dire les avis ou recommandations de techniciens donnés à la demande d’une ou des parties, versés au débat ; cela peur résulter ensuite de son expérience, tirée de litiges similaires, ou enfin des prétentions du demandeur manquant de pertinence, insuffisamment caractérisées ou vouées à l’échec.
Les considérations financières sont plus présentes pour les parties ou leurs conseils qu’elles ne le sont pour le juge qui ne sait pas toujours si telle partie bénéficie ou non d’une protection juridique. La Conférence estime que la décision de recourir à une mesure d’instruction ne devrait pas résulter de la question de savoir qui en supportera le coût. Cependant, outre certains domaines (droit de la filiation par exemple) dans lesquels les considérations financières n’interviennent pas en raison de l’obligation imposée par le législateur de recourir à l’expertise ou de la difficulté particulière de la question, le juge aura parfois le sentiment que l’expertise n’est pas utile et surtout disproportionnée par rapport à l’enjeu, surtout s’il est saisi de litiges aux montants modestes.
L’incitation ne peut que résulter d’une stricte application des textes et en aucun cas elle ne saurait résulter d’une volonté, consciente ou non, de confier, fût-ce indirectement, à un technicien le soin de trancher un litige.
En particulier, pour ce qui est des mesures d’instructions ordonnées en référé au visa de l’article 145 NCPC, même si la jurisprudence n’applique pas de façon rigoureuse la condition prescrite par l’article 146 NCPC, on ne doit pas en conclure qu’il pourrait être ordonné des mesures d’instruction sans lien avec la nécessité d’obtenir ou de conserver une preuve.
C – L’incidence des garanties fondamentales du procès :
La conférence attire l’attention sur le fait que les mesures d’instruction ne sont pas exclusivement régies par les dispositions du nouveau code de procédure civile et qu’il convient de prendre en compte les garanties fondamentales du procès équitable pour autant que leur application s’impose.
La Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas encore complètement investi l’expertise, envisagée de manière autonome mais, parce que l’expertise se déroule sous l’autorité du juge, elle lui applique certaines des règles du procès équitable.
Il est d’ailleurs à noter que la CEDH emploie le terme « expertise » au sens large d’intervention d’un technicien au procès, même en dehors du cadre des mesures d’instruction prévues par le NCPC en France.
Cela ne modifie pas profondément les conditions du recours à l’expertise (par exemple la norme de l’indépendance et de l’impartialité de l’expert), mais l’incidence est plus grande s’agissant des modalités du recours (la durée raisonnable, le principe de la contradiction et l’égalité des armes) appliquées à l’expertise : elle diminue la liberté du juge (cf. par exemple, CEDH 8 mars 1997, Mantovanelli c/. France, Rec. 1997, II, p. 436).
Il ne semble pas toutefois que la Cour européenne des droits de l’Homme ait jamais considéré qu’il existe un droit des parties à faire nommer un expert par le juge ; inversement, il ne semble pas non plus que le juge soit obligé de consulter les parties avant de nommer un expert.
Toutefois, afin de rapprocher les pratiques romano-germaniques et anglo-saxonnes, la conférence considère qu’il serait opportun que soit instauré un débat contradictoire. En effet, les droits de Common Law ne connaissent guère l’expertise judiciaire au sens d’expert nommé par le juge, malgré une évolution récente dans ce sens. En Common Law, ce sont généralement les parties qui nomment leurs experts ; le juge a pour mission, d’inciter les parties à avoir recours à un seul expert ou de les autoriser les parties à recourir à « leur » expert en vérifiant l’absence d’abus puis en contrôlant la discussion contradictoire sur leurs rapports, y compris devant lui.
La réponse :
En définitive, à la question l’expertise est-elle nécessaire à la solution du litige ?, c’est encore le juge qui répond, même si le législateur peut parfois la lui imposer, et si la demande des parties le conduit à en faire débattre contradictoirement, sans pour autant qu’elles partagent ce pouvoir.
II – Réponses aux questions :
Question 1°-1 : Quels sont factuellement les grands types d’expertise ?
Les expertises pourraient être classées selon plusieurs distinctions : par exemple, celle de la procédure utilisée (référés, requêtes, mise en état, au fond), celle de la matière traitée (bâtiment, santé, comptabilité-finance), celle de la nature juridique du litige (responsabilité, contrats, droit de la famille), ou encore celle de la finalité (recherche de preuve du fait, recherche des fautes professionnelles, chiffrage des conséquences). Mais ces classements sont peu opérants, sauf pour le choix du technicien retenu en l’espèce (groupe 2) et la recherche éventuelle d’une mission-type (groupe 3).
Aussi, en pratique, trois critères seront retenus :
Critère Obligation/incitation/dissuasion
L’obligation est prévue par un texte ou son interprétation jurisprudentielle (cf. annexe, les cas d’expertise obligatoire pour le juge). La dissuasion résulte de l’illégitimité de la demande (notamment s’il s’agit de pallier la carence d’une partie), de son caractère dilatoire, obstructif ou tardif – lorsqu’il s’agit d’appeler une nouvelle partie en intervention forcée -, ou encore de la disproportion entre son coût et la valeur de la demande (proportionnalité). L’incitation résulte, dans tous les autres cas, de la volonté du juge de prendre en considération la volonté des parties demanderesses, encouragée par la convergence avec les règles de Common law, de l’évolution de la pratique de « contractualisation », et des possibilités de conférence ouvertes notamment par les articles 266 et 764 NCPC.
Critère de complexité
Ce critère est utile à de nombreux stades de l’intervention du technicien, quoique les textes ne le définissent pas. La complexité peut tenir notamment au caractère de principe de la question à trancher, à la nature et à l’importance des investigations à réaliser, au nombre de parties en cause, ou encore à l’enjeu du litige.
On peut, d’ailleurs, en respectant ces critères, donner une liste, non limitative, de domaines pour lesquels les expertises ne sont pas complexes même si elles peuvent être délicates, sauf cas d’espèces : expertise de mise sous tutelle, de réparation du préjudice corporel, questions relatives à la mitoyenneté et au bornage, contestations sur le prix du bail commercial, enquête sociale, interprétariat, traductions.
Critère de proportionnalité
Ce critère tend à faire respecter le principe du « bon sens » et propose qu’une mesure soit considérée comme injustifiée si son coût est disproportionné ou s’il ne peut pas être invoqué un intérêt supérieur mettant la demande au-dessus de toute valorisation économique (ce qui pourrait par exemple être invoqué dans le cas de l’expertise demandée dans l’intérêt d’une personne vulnérable subissant une souffrance morale).
Il est de bonne pratique que toute demande d’expertise soit soumise à une notation préalable sur les trois critères d’incitation, de complexité et de proportionnalité, afin de répondre notamment aux questions relatives aux cas de refus d’expertise, aux délais ou au coût de celle-ci.
Incidemment, il serait bon d’inciter les autres acteurs du procès, parties et conseils, à en faire de même avant l’introduction de l’instance.
Question 1°-2 : Quels sont les critères de choix entre la constatation, la consultation et l’expertise judiciaire ?
C’est d’abord la nature des questions techniques nécessaires à la résolution du litige qui constitue le premier critère de choix entre la consultation, l’expertise et les autres mesures d’instruction telles l’enquête, le transport, la constatation, et la consultation.
C’est ensuite la difficulté d’apprécier, dès l’origine, la complexité du problème technique posé qui conduit le juge, soucieux de disposer d’informations exhaustives et d’éviter d’avoir à ordonner des investigations complémentaires, à recourir à l’expertise plutôt qu’à la consultation.
Il est de bonne pratique que dans tous les cas simples et non obligatoires, ne répondant pas au critère de « proportionnalité », le juge s’en tienne à la consultation ou à la constatation.
Relation avec la médiation judiciaire
Le recours à un médiateur judiciaire ayant des compétences techniques est de nature à permettre le règlement de certains litiges sans pour autant recourir à une mesure d’instruction. Mais la médiation judiciaire s’inscrit dans un cadre réglementaire différent, constitué par les articles 131-1 et suivants du NCPC ; elle est un moyen économique et rapide de résoudre les conflits. Elle peut être préconisée dans les affaires complexes pour éviter les procès de longue durée à l’issue incertaine. Le juge a le choix de cette mesure, s’il l’estime nécessaire.
Il pourrait alors nommer comme médiateur judiciaire une personne ayant des compétences techniques et pouvant être inscrite comme expert judiciaire. Cette mesure de médiation respecterait l’article 240 NCPC, puisque la mission de médiation ne serait pas à un expert, mais à un médiateur choisi pour ses compétences techniques.
Il est de bonne pratique de proposer une médiation, lorsque les conditions en sont réunies, à l’occasion d’une demande de mesure d’instruction, en la confiant alors à un technicien.
Le jury a également noté l’idée de la consultation utilisée dans les cas exceptionnels pour aider le juge à déterminer les conditions préliminaires de l’expertise, qu’on pourrait appeler le « cahier des charges », dans les cas où le juge n’a pas tous les éléments pour le faire.
Question 2°-1 : Dans quels cas, le juge est-il conduit à refuser une expertise dans une instance contentieuse au fond et en référé ?
Outre les cas où l’application des critères précédents impose ou motive le refus, il existe des cas particuliers. La conférence en retient trois:
– il y a autorité de la chose jugée,
– il y a preuve d’un motif imposant de ne pas recourir à l’expertise (en matière de filiation ou pour des motifs tirés de la protection de la vie privée d’une partie),
– le juge s’estime suffisamment éclairé ou compétent.
Il est de bonne pratique, selon la conférence, de refuser l’expertise en l’absence d’intérêt légitime (ex : autorité de la chose jugée, protection de la vie privée…) ou si une autre mesure d’instruction paraît suffisante. Si aucune partie ne la demande, le juge l’ordonne, quand elle lui apparaît nécessaire au bon déroulement du procès, en la motivant.
Question 2°-2 : Dans quels cas, le juge est-il conduit à refuser une expertise au stade précontentieux (article 145 NCPC) ?
En dehors des cas où la loi la rend obligatoire, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 NCPC, ne pourra refuser l’expertise sollicitée que dans l’une des hypothèses suivantes :
– le procès est déjà engagé devant la juridiction du fond,
– l’absence de motif légitime, c’est-à-dire :
o si le litige potentiel est insuffisamment caractérisé,
o si la prétention est manifestement vouée à l’échec,
o si la mesure est insusceptible de rapporter une preuve utile à la résolution du litige,
o si les intérêts légitimes de la partie adverse peuvent être compromis (secret des affaires, de fabrication, atteinte à la vie privée, recherche illicite de moyens de preuve).
– la mesure demandée n’a pas pour objet l’établissement ou la conservation de preuves.
L’usage de l’ordonnance sur requête pour ordonner une expertise sur le fondement précité est strictement limité au cas où le respect de la procédure contradictoire du référé compromettrait la recherche de la preuve (risque de destruction ou de falsification de documents comptables par exemple).
Il est de bonne pratique de refuser l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 NCPC lorsqu’une instance est déjà engagée au fond, ou en en l’absence de motif légitime (ex. : litige potentiel insuffisamment caractérisé, prétention manifestement vouée à l’échec, intérêt légitime du défendeur, etc.) ou encore si elle ne correspond pas aux prévisions de ce texte.
Question 2°-3 : A partir de quels éléments est-il légitime pour le juge d’ordonner une expertise demandée par les parties ?
L’expertise est un moyen à la disposition du juge pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ; le juge est seul à pouvoir en apprécier l’opportunité.
A défaut de précision par les textes, la « légitimité » est appréciée par le juge (article 232 NCPC).
Il est de bonne pratique de considérer que, même demandée par les parties, l’expertise est à la disposition du juge qui en apprécie la légitimité.
Question 3° : Quelle est l’incidence du coût de l’expertise sur la décision d’y recourir ?
Bien qu’au terme d’un consensus fort, la décision de recourir à une mesure d’instruction ne doive pas résulter de la question de savoir qui en supportera le coût, il est des cas où, pour certaines parties, ce coût a une influence considérable lorsqu’elles financent elles-mêmes l’expertise, alors qu’il leur est indifférent lorsque la charge de celle-ci est supportée par un tiers (assureur, Etat, employeur…).
Le juge s’interrogera sur le fait de savoir si les inégalités de moyens parfois constatées entre les parties ne doivent pas être prises en considération afin que « l’égalité des armes » soit respectée.
Il est de bonne pratique que la décision de recourir à une mesure d’instruction ne résulte pas de la question de savoir qui en supportera le coût.
SUR LE CHOIX DE L’EXPERT
I – Présentation synthétique :
Une fois posé le principe de recourir à une mesure d’instruction pour procéder à des vérifications matérielles ou recueillir des avis et explications techniques permettant d’apprécier la portée d’un litige, le juge doit alors choisir la personne – physique ou morale – du technicien auquel il va confier la mission qu’il souhaite.
Selon l’article 232 NCPC, il jouit d’une totale liberté pour la choisir.
Pour autant, compte tenu de l’importance sans cesse croissante de la place des mesures d’instruction, et de l’expertise en particulier, dans l’appréhension des litiges, il est évident que le choix de la personne du technicien désigné ne peut pas relever du hasard, voire d’un principe de répartition égale du nombre de missions auprès des différents techniciens.
Ce choix est d’autant plus important que s’il est aisé d’ordonner une mesure d’instruction et de choisir un technicien, il est exceptionnel, bien que prévu par le NCPC, de le remplacer, sachant qu’un technicien qui ne remplit pas, ou mal, sa mission peut conduire à un sinistre judiciaire.
La pratique des « listes noires », lorsque celles-ci existent, doit cependant être proscrite, puisque la transparence est de règle.
Le choix du technicien en France
Le juge doit laisser guider son choix du technicien par les éléments qui lui sont connus : les demandes des parties, les informations qui lui sont données par le service des expertises, son expérience de situations similaires ; à défaut, il peut s’informer auprès d’un technicien.
La réforme de 2004 confirme le dispositif sur lequel le législateur compte de façon presque exclusive pour permettre un bon choix du technicien : la tenue de listes périodiquement remises en question par les juges, constituées de professionnels assermentés, soumis à des dispositions disciplinaires rigoureuses et tenus de bien connaître les principes directeurs du procès ; ces différents points sont réaffirmés dans les textes promulgués en 2004.
Il n’est prévu en revanche ni de contrôle des connaissances techniques ni d’astreintes à l’usage de méthodes ou de protocoles définis. En France, le système de contrôle des connaissances, limitées aux principes directeurs du procès et à la procédure expertale, se caractérise par l’absence de dispositif d’agrément des organismes chargés de diffuser celles-ci et des problèmes de logistique rendent même aléatoire la mise en œuvre d’un entretien individuel, lors de l’instruction ou de renouvellement du dossier de candidature.
Les références à l’étranger
L’évolution de « l’expertise juridictionnelle » en Grande-Bretagne est très éclairante ; elle comporte des dispositions destinées à limiter les mesures d’expertise à ce qui est suffisant pour la solution, en retenant ce qui est le plus simple et le moins onéreux. La partie souhaitant appuyer sa démonstration sur une expertise devra y être autorisée, en définissant son domaine et en identifiant le technicien approprié quand c’est possible. Ce technicien n’est soumis à aucune sélection de l’autorité judiciaire ; il ne devra sa capacité à retenir l’attention des parties requérantes qu’à sa compétence et à sa réputation.
L’Allemagne a adopté une solution similaire à celle de la France par la tenue de listes d’aptitude, avec une différence notable, puisque le contrôle des aptitudes s’effectue par l’intermédiaire des professionnels eux-mêmes, après agrément des institutions ou organisations qui en sont chargées.
Aux Etats-Unis d’Amérique, la logique de « l’expert witness » a conduit la jurisprudence à exiger, à l’occasion de chaque procès et avant l’examen au fond, le contrôle et la validation de la compétence de l’expert ; au travers de ce qu’un auteur appelle « l’épistémologie jurisprudentielle », le juge ne se fiera pas à la seule expérience reconnue de l’expert, mais se fera le gardien vigilant de la validité des savoirs qu’il avance à l’appui de sa démonstration, en vérifiant que l’expertise s’est bien trouvée soumise à une méthodologie suffisamment éprouvée dans le domaine concerné.
Les autres références
Il est pris acte des pratiques contractuelles de résolution alternative des conflits (arbitrage, médiation judiciaire), où la « contractualisation » permet de mobiliser les acteurs (magistrats, avocats, « experts ») autour d’une approche négociée du processus envisagé de manière pragmatique.
La conférence a enfin retenu, pour l’évolution des bonnes pratiques à moyen terme, le développement des normes du type ISO 9001 version 2000, avec leur transposition au domaine de l’expertise, la norme AFNOR NF X50-110. Il s’agit d’un outil de sélection reposant sur le processus de contrôle de la qualité de l’expertise, auquel l’expert accepterait de se soumettre.
De ce point de vue, toutes les mesures d’instruction obéissent aux mêmes règles, qu’elles soient décidées en référé, sur requête, sur le fondement de l’article 145 NCPC ou à quelque moment de l’instance que ce soit : c’est la garantie de la qualité du processus qui importe.
II – Réponses aux questions :
Question 1° : Faut-il, le cas échéant dans quels cas, dissocier la décision de recourir à l’expertise de la décision sur le choix de l’expert ?
Deux possibilités ont été envisagées par le groupe de travail :
– la mise en délibéré de l’affaire concernant la désignation de l’expert de façon à ce que le tout fasse l’objet d’un prononcé global et simultané à une date fixée lors de l’audience ;
– un travail plus approfondi de préparation par le juge avant l’audience de référé.
Par ailleurs, le groupe de travail s’est interrogé sur une autre voie ne pouvant se concevoir en référé (puisqu’en ordonnant un constat ou une consultation le juge des référés vide sa saisine) : la juridiction saisie au fond pourrait se limiter, dans une décision avant dire droit, à la réalisation d’une mesure de constatation ou de consultation, quitte, à l’occasion d’une nouvelle audience, à décider, s’il y a lieu, d’une mesure d’expertise au vu des résultats de la première mesure.
Le jury estime pour sa part qu’une telle dissociation n’est pas possible.
Il n’est pas de bonne pratique de dissocier la décision du choix de l’expert de la décision de recourir à l’expertise, mais le juge peut mettre l’affaire en délibéré, ou la renvoyer contradictoirement à bref délai pour statuer par une seule et même décision.
Question 2°-1 : Peut-on, et si oui comment, choisir l’expert hors liste ?
La notion de « liste » est ici entendue au sens large, qu’il s’agisse de la liste des experts agréés par la Cour de cassation, ou qu’il s’agisse de la liste de la cour d’appel du ressort, ou encore des cours d’appel voisines, en ce inclus les experts à titre probatoire.
Il faut noter également que les services des expertises dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance importants, tiennent ces listes à la disposition des juges.
La désignation d’un expert hors liste suscite une première réserve : soit le choix de l’expert hors liste procède de recommandations difficilement vérifiables, soit elle implique que le juge connaisse personnellement l’expert qu’il va désigner, puisqu’on n’imagine pas que cette désignation intervienne sans justification, ce qui renvoie alors à la question de l’indépendance de l’expert vis-à-vis du juge qui le désigne.
La désignation d’un expert hors liste impose des précautions particulières : il est nécessaire qu’il ait conscience qu’il devra respecter une « déontologie » et les règles de procédure civile visées sous les articles 233 à 248 et 273 à 285 NCPC. Il devra également pouvoir justifier d’une garantie d’assurance suffisante couvrant une éventuelle mise en cause de sa responsabilité civile résultant de la mission. Dans le silence des textes, la nécessité d’une prestation de serment est controversée en jurisprudence. Le jury recommande au juge de leur faire prêter serment. L’expert nommé hors liste sera pour le reste soumis aux obligations communes à tous les experts et en particulier à la pratique de la déclaration d’indépendance.
Le juge, de manière exceptionnelle pourra désigner un expert hors liste, par exemple si la spécialité requise n’est pas prise en compte par l’actuelle nomenclature, ou si la renommée et la compétence spécifique du technicien le justifie.
Dans le cas où il s’avérerait utile de faire appel à un homme de l’art dans une spécialité très particulière, dite « fine », il serait opportun de désigner un collège d’au moins deux experts, dont l’un sera inscrit sur une liste (ce dernier aura une expérience affirmée de l’expertise).
Il n’est pas de bonne pratique de choisir l’expert hors liste. Un tel choix doit être justifié par des raisons particulières et nécessite de la part de l’expert ainsi désigné le respect des contraintes inhérentes à l’expertise. Il est de bonne pratique de lui faire prêter serment.
Question 2°-2 : Peut-on, et si oui comment, choisir l’expert en concertation avec les parties ? Quelle serait la forme de cette concertation ?
La conférence retient que le juge n’est aucunement tenu de retenir la proposition des parties.
Toutefois, la récente convention tripartite signée le 4 mai 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris, l’union des compagnies des experts, et le bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris, prévoit le principe de la concertation avec les parties dans la désignation et le choix de l’expert. Sa généralisation en France inciterait le juge à utiliser cette source d’information, à ne pas négliger une occasion de rapprocher les parties et à favoriser un démarrage consensuel des opérations expertales.
Cette solution est partagée par le droit anglais, où la jurisprudence fait expressément référence à la nécessaire « confiance que les deux parties doivent avoir dans l’expert unique » (Affaire Quarmby Electrical Ltd/Tant), dès lors qu’elles choisissent de s’en remettre à un expert commun et de ne pas commettre chacune leur expert.
La solution alternative ou complémentaire consisterait à ce que les parties et leurs conseils aient accès largement aux informations rassemblées par les services des experts des cours d’appel et que les experts puissent faire connaître sous leur propre responsabilité les informations les concernant qu’ils jugent pertinentes, par exemple en donnant l’adresse de leur site sur l’Internet.
Il est de bonne pratique que le juge prenne en considération, dans la désignation de l’expert, la proposition conjointe des parties, ou celle d’une ou plusieurs d’entre elles dès lors qu’aucune ne s’y oppose, étant observé qu’il demeure toujours libre de son choix.
Question 3° : Comment vérifier si la compétence de l’expert pressenti est en adéquation avec la mission ? Le contact préalable du juge et de l’expert est-il nécessaire ? Souhaitable ? Si, oui, dans quels cas et sous quelles formes ?
La vérification de la compétence s’effectuera systématiquement par la consultation de systèmes d’information mis à la disposition du juge et, le cas échéant, par un contact personnel entre le juge et l’expert.
Un contact préalable du juge et de l’expert
En l’état, aucune disposition ne règle cette question.
Le contact personnel est difficile à organiser. Aussi, le premier contact (téléphonique ou par voie électronique,…) est-il couramment pratiqué par souci de rapidité, tant par le juge ordonnateur que par le juge du contrôle.
Le contact entre le juge et l’expert ne devra porter que sur des questions générales telles que l’expérience du technicien, sa disponibilité, les moyens techniques dont il dispose. Il ne devra pas aborder les circonstances de l’espèce, sauf si le contact peut être ouvert à la contradiction des parties. Dans les cas complexes, le contact pourrait avoir lieu contradictoirement.
Un débat contradictoire sur la mission de l’expert lui confèrerait la légitimité nécessaire à la conduite des opérations d’expertise et la confiance des parties en renforçant son autorité.
Il est de bonne pratique d’établir un contact préalable avec l’expert, portant sur des questions générales et non pas sur l’espèce. Ce contact peut être téléphonique ou par voie électronique. Dans les cas complexes, il doit être organisé contradictoirement au début de l’instruction.
Adéquation de la compétence avec la mission
La vérification de l’adéquation de la compétence de l’expert avec la mission est une question cruciale pour le bon déroulement de la mission. Pour ce faire le juge, dispose de certains outils.
Les listes
Le juge peut se référer directement aux listes tenues conformément aux textes en vigueur dans lesquelles il trouvera un classement des experts selon une nomenclature établie par décret.
Le classement d’un expert dans une spécialité est décidé au moment de son inscription, sur la base des renseignements qu’il a fournis.
Dans le cas de techniciens appartenant à des professions réglementées (médecins, experts-comptables, architectes), l’appartenance à l’une de ces professions apportera des garanties de compétence technique. Dans les autres cas, la production de diplômes et de références professionnelles, constitueront l’essentiel des garanties. Dans aucun cas, il n’est prévu de contrôle d’aptitude technique spécifique à l’expertise.
Par ailleurs, afin d’apprécier leurs compétences procédurales, les experts doivent, lors de leur renouvellement quinquennal – ou septennal pour la liste nationale – faire état des formations suivies sur les principes directeurs du procès.
Les autres sources d’information
Les compagnies d’experts ont le plus souvent établi des bases de données permettant d’obtenir des informations sur les compétences techniques des experts qui en sont adhérents.
Ces compagnies, dispensent, le plus souvent en relation formelle ou informelle avec les magistrats, des formations aux principes directeurs du procès et aux techniques expertales. Elles publient l’annuaire de leurs adhérents, sous forme de document-papier ou d’accès à des sites Internet.
Il n’existe pas aujourd’hui, hormis de rares exceptions locales, d’outils permettant l’accès à d’autres informations.
La conférence a pris note de l’exemple des communautés scientifiques et universitaires qui ont élaboré des recensements de publications, complètes ou abrégées ; cette pratique systématique est la base de la réputation des professionnels concernés et sert à juger de leur compétence et de leur légitimité. Ces collections sont accessibles publiquement et le plus souvent gratuitement par le réseau Internet.
Ces bases sont hébergées en réseau sur des sites peu onéreux ; les mises à jour sont effectuées par les personnes concernées et constituent aussi leurs propres archives.
Il est de bonne pratique que dans les cas d’urgence et dans les schémas simplifiés, le contrôle de l’adéquation de la compétence de l’expert pressenti avec la mission soit fait par référence à la proposition des parties ou par l’appartenance de l’expert à une liste dans la rubrique adéquate, telle qu’elle est tenue par le service des expertises. A la demande du juge, le service des expertises peut fournir quelques noms sous forme d’une « courte liste ».
Dans les autres cas, ce contrôle d’adéquation s’effectue soit a priori en fonction des références de nomenclature et de spécialité figurant sur la liste des experts, et éventuellement après un appel téléphonique à l’expert, soit a posteriori par l’expert lui-même qui, en acceptant la mission, a vérifié que sa compétence était bien en adéquation avec le litige.
Ces deux pratiques sont acceptables faute de mieux en l’état.
Question 4° : Dans quels cas est-il utile pour le juge de disposer d’informations pour choisir un expert ? De quelles informations (ou instruments) le juge doit-il disposer pour choisir un expert (informations sur l’art exercé, son activité professionnelle actuelle, sa charge de travail, le coût moyen ou médian de ses opérations, la durée moyenne de ses missions d’expertise, les contentieux engendrés par les expertises précédentes, etc.) ?
Dans tous les cas, pour effectuer un choix pertinent, la conférence retient que le juge devrait disposer de toutes les informations nécessaires, notamment :
– la charge de travail de l’expert qu’il envisage de nommer et sa performance acquise dans le respect des délais de ses expertises,
– le niveau de compétence technique,
– les moyens d’organisation dont il dispose,
– le coût habituel de ses expertises,
– la mise à disposition d’une sélection de rapports anonymisés,
– son cursus professionnel hors expertise judiciaire, et notamment sa formation permanente,
– l’adéquation de sa formation à l’expertise judiciaire,
– son aptitude à appliquer la méthodologie de missions-types et de missions normalisées,
– les incidents éventuels liés à sa personnalité et son aptitude à gérer les situations conflictuelles.
Mais se pose alors la question de la collecte de ces informations et de leur diffusion : certaines dont le caractère personnel exigerait des précautions particulières sous réserve de l’avis de la CNIL (charge de travail, personnalité et aptitude à la confrontation, durée et coût moyens des missions) pourraient être recueillies auprès des juges.
Il est indispensable qu’une réflexion soit lancée, avec un objectif de réalisation d’un outil adéquat à moyen terme.
Il n’est pas de bonne pratique que chaque juge constitue sa propre base de données ; il est au contraire recommandé que les données soient centralisées et partagées.
Question 5° : Dans quels cas le juge doit-il désigner un collège d’experts plutôt que de laisser l’expert s’adjoindre un sapiteur, technicien d’une autre discipline ?
La nomination de plusieurs experts est une faculté offerte au juge et prévue par l’article 264 NCPC.
Un collège d’experts peut être utile, voire nécessaire, par exemple quand la nature de l’affaire nécessite des experts de plusieurs spécialités différentes, ou lorsque les contraintes de délai l’imposent, ou encore lorsqu’il y a un travail matériel trop important pour qu’un seul expert puisse l’effectuer.
Il n’est pas démontré qu’un collège soit en définitive plus coûteux qu’un expert unique, si les coûts supplémentaires de coordination sont compensés par les gains de productivité et de qualité de chaque spécialiste. C’est au contraire, en général, par la spécialisation fonctionnelle qu’on parvient à améliorer l’efficacité.
La considération du coût ne limitera pas a priori le recours à un collège d’experts.
Le recours à un collège d’experts ne doit concerner que les cas les plus complexes et doit donner lieu à la désignation d’un coordonnateur ou d’un président du collège expertal – pouvant aider préalablement à la définition des spécialistes à faire intervenir – pour assurer l’efficacité du déroulement de la mesure et la répartition des opérations entre les membres du collège.
Les éventuelles différences d’appréciation entre les experts désignés seront mentionnées.
La désignation d’un sapiteur par l’expert procède d’une vision différente. En effet, elle ne s’applique qu’à des opérations plus limitées voire courantes et tend à répondre au besoin exprimé par l’expert désigné de s’adjoindre un technicien d’une spécialité différente de la sienne pour une intervention réduite.
Dans cette hypothèse, c’est l’expert – et non le juge – qui, sous sa responsabilité, procède à la désignation du sapiteur de son choix, qui en assume le contrôle et prévoit les honoraires de celui-ci et les lui règle directement. Bien évidemment, le juge doit veiller à ce que cette désignation ne présente pas un caractère de convenance personnelle et corresponde bien à une nécessité qui doit être justifiée tant auprès de lui que des parties. Ce sapiteur devra de préférence être choisi parmi les experts judiciaires.
La question du coût de l’intervention du sapiteur est sans doute un problème mal posé car il faut examiner le coût de l’expertise dans sa globalité.
Le choix par l’expert de son propre technicien (le sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne comporte le risque d’un choix ne présentant pas toutes les garanties requises en termes d’impartialité et d’indépendance, voire de compétence. Il devrait donc être limité à un rôle circonscrit et non sujet à controverse quant à la technique ou science impliquée, limité dans son objet et dans son coût. L’expert qui confierait à un sapiteur une part trop importante de sa mission enfreindrait les dispositions de l’article 233 NCPC (interdiction de la sous-traitance).
Ces questions ne semblent pas devoir être distinguées de la faculté dont disposent désormais les experts de faire intervenir tel collaborateur de leur choix, sous leur responsabilité et leur contrôle. Une telle intervention procède d’une autre idée, celle de faire exécuter certains travaux à la charge de l’expert désigné (ce qui officialise les prestations réalisées par les collaborateurs de cabinets d’experts), notamment en matière comptable ou de construction.
Il est de bonne pratique, dans les cas les plus complexes, de désigner un collège d’experts et de charger l’un d’eux d’en assurer la coordination ou la présidence.
Le recours à un tel collège ne devrait pas nécessairement être décidé lors de la première réunion, mais ordonné rapidement, après avis de l’expert désigné et des parties.
Il est de bonne pratique que le juge désigne le coordonnateur ou le président du collège, chargé des tâches administratives et de la répartition des travaux techniques au sein de l’expertise.
Il est de bonne pratique de recommander à l’expert d’en référer au juge lorsque l’intervention d’un sapiteur, choisi dans les conditions prévues par le NCPC, est susceptible de présenter des difficultés.
Question 6° : Comment apprécier l’indépendance de l’expert ?
L’expert prête le serment suivant : « je jure d’apporter mon concours à la justice, d’accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner mon avis en mon honneur et en ma conscience ». Mais il est de plus soumis aux obligations qui découlent de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la jurisprudence de la Cour européenne.
Question 6°-1 : Faut-il lui demander de faire une déclaration d’indépendance ?
Question 6°-2 : Si oui, sous quelle forme ?
La conférence constate que cette pratique est de plus en plus répandue.
Par exemple, en ce qui concerne les instances de l’Union Européenne ou le domaine médical, l’AFSSAPS vient de réformer sa gestion des risques de conflits d’intérêts de ses experts en les obligeant à « une déclaration d’intérêts mentionnant leurs liens directs et indirects avec les entreprises ».
On a cité aussi l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui a modifié son règlement, pris en application du code de commerce et du code monétaire et financier, en imposant aux experts désignés lors des offres publiques d’achat une déclaration formelle d’indépendance ; des organismes privés internationaux pratiquent de même systématiquement cette exigence auprès de leurs experts (ex : le centre de règlement des litiges de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève).
Enfin, le règlement d’expertise de la Chambre de commerce internationale (CCI), entré en vigueur le 1er janvier 2003, dispose qu’ « avant toute proposition, l’expert pressenti signe une déclaration d’indépendance et fait connaître par écrit au Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit de la personne faisant la demande de proposition. Le Centre communique ces informations par écrit à ladite personne en lui fixant un délai pour faire connaître ses observations éventuelles ».
Cette pratique est également utilisée en matière d’arbitrage.
Dans le domaine judiciaire déjà, les experts appelés dans certains actes de sauvegarde des entreprises sont soumis à une déclaration avant leur nomination dans chaque espèce.
Faut-il, pour autant, transposer cette obligation à l’ensemble des expertises civiles ?
La déclaration d’indépendance de l’expert pourrait paraître inutile car elle semble faire double emploi avec sa prestation de serment.
Cependant, outre l’obligation générale d’indépendance de l’expert contenue dans le serment qu’il a prêté, il est nécessaire de vérifier au cas par cas, qu’à sa connaissance, aucun élément ne puisse apparaître comme pouvant porter atteinte à son indépendance.
Il est de bonne pratique de faire souscrire à l’expert, dans tous les cas, une déclaration d’indépendance, sous la forme d’une attestation pré-rédigée qui lui sera envoyée par le greffe avec l’avis de désignation. L’expert indiquera, ou bien qu’il renonce à la mission qui lui est proposée, ou bien qu’il l’accepte. En cas d’acceptation, l’expert déclarera, soit purement et simplement qu’il est indépendant, soit qu’il est indépendant mais que dans un souci de transparence, il souhaite porter à la connaissance du juge et des parties des éléments d’information qu’il estime ne pas remettre en cause son indépendance.
Question 6°-3 : La fidélisation des relations entre juge et expert est-elle compatible avec l’indépendance de l’expert ? Avec l’indépendance du juge ?
Le terme de « récurrence » apparaît plus adapté que celui de « fidélisation ». Le besoin de transparence, notamment vis-à-vis des parties, doit être assuré.
Il est de bonne pratique que le juge agisse avec réserve à l’égard des experts.
Question 6°-4 : Quelle est la place respective des experts judiciaires et des experts de parties ?
La conférence considère que les techniciens qui assistent des parties, qualifiés « experts de partie », ont leur place dans le procès. Ils doivent être appelés, sur les questions de leur compétence exclusivement, pour éclairer les parties et leurs conseils. Ils ne peuvent les représenter. Il y a lieu, dans le cadre général du procès équitable, de se rappeler que la partie qui n’est pas assistée se trouve souvent en situation de faiblesse vis-à-vis de l’expert judiciaire, ce qui doit conduire le juge à une grande prudence.
La conférence reconnaît une spécificité des expertises médicales du fait que la plupart sont réalisées dans un cadre amiable, voulu par le législateur et que l’expertise judiciaire y fait figure d’exception (loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation). Les médecins « de compagnies d’assurances », dont le nombre pour l’indemnisation des victimes est nettement supérieur à celui des experts judiciaires, coexistent avec ces derniers, en deux catégories plus ou moins strictement séparées selon les ressorts de cours d’appel.
Or, la démarche de l’expert judiciaire médecin le conduit à donner des informations objectives, en réponse à des questions précises incluses dans une mission-type bien définie par le juge : « l’indépendance » de l’expert, dans le cadre d’un rapport d’expertise argumenté et transparent, n’apparaît dès lors pas plus discutable que celle d’un autre expert judiciaire, sauf à être liée à une partie de l’espèce.
La conférence a connaissance de la pratique selon laquelle les experts intervenant pour des compagnies d’assurances étaient, dans certaines cours d’appel, écartés par principe de la liste des experts, et s’est interrogée sur son bien-fondé.
Le jury s’est prononcé en faveur d’une inscription contrôlée sur les listes.
Il est de bonne pratique que le juge accorde une attention particulière aux procès dans lesquels des parties ne sont pas assistées par des techniciens en veillant particulièrement au respect du principe du contradictoire à leur égard.
SUR LA DEFINITION DE LA MISSION D’EXPERTISE
Question 1°-1 : le juge doit-il définir la mission d’expertise en concertation avec les parties et/ou en relation avec l’expert pressenti ?
Le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, doit fixer les termes et l’étendue de la mission conformément aux prescriptions de l’article 265 NCPC, au moins dans les cas où l’expertise n’est pas obligatoirement prévue par les textes.
Cependant la mission d’expertise n’est pas figée ; elle peut évoluer et être modifiée, ainsi qu’il résulte des articles 236 et 279 NCPC.
Le juge ne peut s’en tenir aux écritures des parties.
Il est essentiel, et plus encore dans le cas d’une demande d’expertise formulée sur le fondement de l’article 145 NCPC, que les faits invoqués soient clairement et précisément indiqués dans l’assignation et que la partie demanderesse en premier, et éventuellement la partie défenderesse, proposent une mission adaptée au cas d’espèce et ne se contente pas de se référer, selon une formule trop souvent utilisée bien que dénuée de portée, à la « mission habituelle ».
En l’absence de proposition de mission et d’éléments suffisants pour « bâtir » cette mission, il y aura lieu pour le juge de renvoyer les parties à une audience ultérieure afin d’obtenir ces éléments et une proposition de mission.
Dans ce cadre, même en l’absence de contestation, le juge ne peut toutefois se contenter de s’en remettre aux propositions des parties. Il doit contrôler leurs demandes.
Mais le juge doit-il associer l’expert à la définition de la mission ?
En pratique, il arrive fréquemment que le juge, avant de libeller définitivement la mission, prenne contact avec l’expert pressenti afin de s’assurer de sa disponibilité et de sa compétence au regard du problème posé mais aussi afin de bien « cadrer » ladite mission.
Cette pratique, souvent officieuse, présente l’inconvénient de ne pas respecter le principe de la contradiction. Faut-il pour autant organiser un véritable débat contradictoire entre le juge, les parties et l’expert ?
Il est de bonne pratique que le juge :
– invite les parties à définir de manière claire et précise la mission dont elles demandent l’exécution ;
– vérifie que le projet de mission est conforme aux textes applicables à l’espèce, relève du domaine de la compétence technique de l’expert et s’assure qu’il dispose des moyens pour l’exécuter ;
– recoure, dans les cas les plus complexes, aux dispositions de l’article 266 NCPC.
Question 1°-2 : Les parties peuvent-elles contractualiser la mission à soumettre au juge ?
Le procès civil doit demeurer la « chose des parties », mais le juge le conduit : il décide de l’expertise, choisit l’expert, définit sa mission, contrôle les opérations d’expertise et fixe son coût.
Une fois saisi, l’expert dirige ses opérations ; en cas de difficulté, il en réfère au juge.
Ainsi, l’expert convoque les parties, avise leurs représentants, assure personnellement l’exécution de sa mission, effectue ses opérations en présence des parties et fait respecter en toutes circonstances le contradictoire entre les parties.
Il convient de rappeler que de nombreux pays européens, y compris la France, interdisent la délégation du pouvoir du juge à l’expert.
Se pose alors la question de savoir si l’expert doit s’engager sur la voie d’une simple concertation ou d’une véritable « contractualisation » avec les parties.
Il convient ici de prêter attention à la distorsion qui existe entre l’idée qui se dégage de l’emploi de ce terme et son sens juridique.
L’idée est séduisante ; elle figurait déjà dans le rapport Coulon. Elle repose sur une volonté d’amélioration de la procédure grâce à une plus grande implication des parties dans les décisions prises par le juge pour mener l’instance, en cherchant, autant que faire se peut, à connaître leur position et à adapter les mesures à leurs souhaits communs. En définitive, c’est de concertation qu’il s’agit entre les parties d’une part, l’expert de deuxième part, et le juge.
Le sens juridique du mot accord, ou contrat, est défini : il correspond à un acte qui entraîne des effets juridiques et en premier lieu celui de sa force obligatoire : les personnes liées sont celles qui ont souscrit cet accord. S’agissant du seul accord entre parties, ou de celui intervenu entre les parties et l’expert, il ne peut être question d’imposer au juge de manière générale de prendre une mesure pour cette seule raison que les parties le souhaitent. S’agissant même d’un accord entre parties et expert qui serait entériné par le juge, il ne peut être question de considérer que le juge est définitivement lié par celui-ci ; en effet, dans l’exercice du pouvoir de direction de l’instance qui est le sien, il doit pouvoir revenir sur cet accord si cela est nécessaire. En définitive, le juge n’est jamais partie – au sens juridique – à un accord avec les parties au cours de l’instance. L’accord entre les parties et l’expert constitue une sorte d’engagement moral vis-à-vis du juge et pousse ceux qui l’ont conclu à veiller à tenir les délais et à suivre la procédure retenue initialement.
Il est de bonne pratique pour le juge d’inciter, sous son contrôle, à une concertation, parfois évoquée par le terme impropre de « contractualisation », entre les parties ou entre l’expert et les parties afin de les laisser s’entendre sur l’organisation des opérations d’expertise. Le juge ne saurait être lié par cet accord qu’il pourrait cependant avaliser tout en gardant la possibilité de le modifier ultérieurement.
Question 2°-1 : dans quels cas le juge ne doit-il pas utiliser une mission type ?
La conférence s’est interrogée sur l’utilisation des missions-types. Pour les affaires simples et répétitives, elles peuvent constituer une solution.
Mais elles peuvent aussi être utilisées dans des cas complexes s’ils sont suffisamment répétitifs : par exemple, certaines expertises médicales en matière de responsabilité ; elles semblent d’ailleurs « normalisables », aussi bien dans leurs aspects « procéduraux » que dans la méthode d’analyse.
Dans ces cas, plutôt que de mission-type, on pourrait donc parler de mission normalisée.
En effet, la normalisation est un processus d’établissement de référentiels, admis par un ensemble de professionnels qui s’y obligent ou y sont obligés ; un processus de contrôle permet en général la vérification de la bonne application de la norme.
Les missions-types sont d’ailleurs une pratique déjà courante, notamment dans le cadre des référés de l’article 145 NCPC.
On comprend que la mission-type, utilisée actuellement en référé, ne peut s’appliquer mécaniquement dans tous les cas, même simples, et dans toutes les disciplines. Cela n’en condamne pas le principe, même pour les expertises comptables et financières ou certaines expertises de responsabilité médicale, ou plus généralement en matière de responsabilité, puisqu’on peut imaginer des missions-types modifiables.
Il est de bonne pratique de recourir aux missions-types dans les cas simples et répétitifs, ainsi que dans certains cas complexes. Les juges et les parties devraient s’y référer le plus souvent possible et ne choisir une mission spécifique que par défaut ou dans les autres cas complexes.
Question 2°-2 : Faut-il modéliser les missions-types ?
La modélisation des missions-types est nécessaire.
Cette modélisation n’est pas demandée au juge lui-même, mais pourrait être faite dans une concertation nationale organisée entre l’autorité judiciaire et les autres parties intéressées.
Le domaine d’application des missions-types serait ainsi élargi. Il est donc souhaitable que dans un premier temps, les missions utilisées par les juridictions du premier degré soient recensées et centralisées par les cours d’appel. Une diffusion à l’échelon national devrait par la suite être entreprise.
Il est recommandé, après recensement par les cours d’appel des pratiques de leurs juridictions, de modéliser les missions-types et de les diffuser au plan national.
Question 2°-3 : Peut-il renvoyer aux conclusions des parties pour préciser les contours de la mission ?
Le renvoi aux conclusions des parties aurait pour conséquence de ne pas fixer les limites de la mission de l’expert et serait sujet à des interprétations différentes des parties sur le contenu de la mission.
Il est de bonne pratique que le juge organise une concertation entre les parties pour définir les contours de la mission. Il est de bonne pratique, quand bien même le juge aurait fait application des dispositions de l’article 455 NCPC en ne visant que les écritures des parties, que dans tous les cas, le dispositif détaille la mission confiée à l’expert ou indique comment ses contours seront définitivement arrêtés.
Question 3°-1 : la mission peut-elle préciser la méthodologie que devra employer l’expert ?
Méthodologie
Il convient d’établir ici une distinction entre méthodologie procédurale, méthodologie expertale et méthodologie technicienne.
La méthodologie procédurale consiste dans la mise en œuvre des actes nécessaires aux principes directeurs du procès, au premier rang desquels le respect de la contradiction.
La méthodologie expertale est l’extension des principes directeurs du procès civil et la prise en compte des méthodes générales d’expertise, décrite par exemple dans la norme AFNOR X50-110, pour aboutir à l’organisation de l’expertise en l’espèce ou dans les cas analogues.
La méthodologie technicienne relève de la vérification de l’application de règles de l’art, de normes et réglementations professionnelles, de méthodes spécifiques de recherche des causes de désordres ou de méthodes scientifiques pour la résolution des questions posées, dépendant à l’évidence du domaine et de la mission, qu’elle soit type ou spécifique.
On conviendra d’appeler méthodologie l’ensemble des méthodologies expertale et technicienne.
La méthodologie procédurale de l’expert issue du NCPC ne pose aucun problème ; quant à elles, les méthodologies expertale et technicienne, quant à elles, sont du ressort de l’expert et doivent être présentées et mises en place contradictoirement avec les parties.
Il est à noter qu’à la différence du système nord-américain qui donne au juge la mission de vérifier la validité scientifique de la méthode (cf. en annexe, A. Blumrosen, « L’expertise judiciaire civile en droit américain »), les systèmes européens n’imposent pas cette charge au juge : aucune jurisprudence de la CEDH ou des cours suprêmes nationales ne va dans ce sens, même au nom du « procès équitable » ; il ne semble pas que l’assurance de la recherche de la vérité scientifique apparaisse comme nécessaire à l’équité.
Certains pensent, de plus, qu’imposer une méthodologie particulière à l’expert, lui dicter des diligences, conduirait à le priver de son libre arbitre et de son indépendance et pourrait nuire à l’objectivité de son avis.
Il ne fait toutefois guère de doute, à entendre les commentaires des communautés scientifiques et techniques, que le recours à une méthodologie est un facteur déterminant, d’abord de la qualité des expertises, ensuite de la capacité à faire comprendre et admettre leurs résultats.
La conférence estime que le choix de la méthodologie et sa validation ne sont pas du ressort du juge. Il n’en reste pas moins qu’une méthodologie, tant expertale que technicienne, s’impose.
Il est de bonne pratique que le juge :
– demande à l’expert de préciser contradictoirement la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations ;
– rappelle dans sa décision les termes de l’article 279, alinéa 1er, NCPC affirmant le principe selon lequel « en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert doit en référer au juge ».
Question 3°-2 : La mission doit-elle préciser que l’expert indiquera aux parties sa méthodologie dans un délai déterminé ?
Le choix de la méthodologie doit être soumis à la contradiction des parties. Ce débat permet d’ailleurs, le plus souvent, d’affiner la méthodologie proposée par l’expert, voire de la compléter.
Dans les cas simples d’expertise, et ceux qui devraient relever de la consultation, la mission-type contient sa propre méthodologie, tant expertale que technicienne.
Dans les cas complexes, il est nécessaire que l’expert prenne connaissance du dossier pour être en mesure de préciser sa méthodologie. Il paraît possible de lui imposer un délai pour la faire connaître.
On convient toutefois que la discussion contradictoire de la méthodologie doit intervenir le plus tôt possible, car l’estimation des coûts et des délais en dépend.
Il est de bonne pratique de ne pas imposer une méthodologie à l’expert sauf le cas de missions-types ou normalisées qui contiendraient leur propre méthodologie ; mais il est de bonne pratique que la décision du juge indique comment et quand la méthodologie que devra employer l’expert sera précisée et arrêtée.
Question 4° : Est-il opportun, et si oui dans quel cadre et à quels stades, de provoquer une discussion sur les contours de la mission initialement fixée ?
L’article 266 NCPC permet cette pratique. Cela implique une décision en deux temps : tout d’abord, le juge ordonne une expertise puis invite les parties et l’expert à se présenter à une audience ultérieure pour que soient évoqués la définition de la mission et le calendrier des opérations ; ensuite, au vu des conclusions de cette concertation, il fixera en connaissance de cause le cadre de la mission.
Cette possibilité offerte par l’article 266 NCPC, présente cependant l’inconvénient d’allonger les délais et d’augmenter les coûts.
Dans ces conditions, le recours à l’article 266 NCPC devrait être réservé aux affaires les plus complexes.
Dans le cas des affaires simples, il appartient au juge de fixer précisément la mission de l’expert. Le seul renvoi à l’assignation ou aux conclusions des parties, selon le moment de la demande, n’apparaît cependant ni opportun, ni efficace.
Il est de bonne pratique que le juge, dans tous les cas où il apparaît des difficultés, et en particulier des retards organise une discussion contradictoire sur les contours de la mission initialement fixée. Le cas échéant, il pourra modifier le dispositif initial par une nouvelle décision.
SUR LES DELAIS ET LE COUT DE L’EXPERTISE
I – Présentation synthétique :
Du service des expertises
Il apparaît nécessaire d’approfondir la question de la répartition des compétences entre le juge chargé du contrôle des expertises et celui ayant ordonné la mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 155-1 NCPC, le président de la juridiction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction.
L’article 155 NCPC dispose que la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée. Celui-ci peut avoir recours au juge désigné par le président de la juridiction.
Il apparaît opportun d’opérer une distinction entre le juge des référés et le juge du fond.
Alors que le juge du fond qui ordonne une mesure d’instruction n’est pas dessaisi, le juge des référés qui statue sur le fondement de l’article 145 NCPC épuise sa saisine, sauf s’il se réserve le contrôle de la mesure. Il pourrait sembler ainsi logique de considérer que le contrôle des mesures ordonnées en référé relève du service des expertises et que le suivi de l’expertise ordonnée au fond relève du juge du fond.
Toutefois, la conférence estime qu’il serait de bonne pratique qu’un service unique assure le suivi de toutes les procédures quel que soit le juge qui les a ordonnées, sauf si celui-ci, dans des cas particuliers (expertise complexe ou autre) s’en est réservé expressément le contrôle.
Il est de bonne pratique que tant le juge des référés que le juge du fond indique toujours dans la décision s’il entend ou non se réserver le contrôle de la mesure afin que les parties et l’expert en soient informés clairement.
Il apparaît nécessaire d’organiser un service des expertises dans chaque juridiction.
Cette organisation est fondamentale : il ne sert à rien de disserter sur la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, la définition de la mission, les délais et le coût si les juridictions sont dans l’incapacité de gérer l’ensemble d’une manière pratique et centralisée.
Bien plus, il est indispensable d’institutionnaliser un véritable service des mesures d’instruction qui ne se limiterait pas au seul suivi des expertises.
Ses compétences seraient notamment les suivantes :
– intervenir après la saisine de l’expert pour tout ce qui concerne le suivi de la mission (provision complémentaire, prorogation des délais, extension à de nouvelles parties, réception des déclarations d’indépendance, etc.),
– fixer la rémunération de l’expert,
– adresser à l’expert la copie de la décision ayant statué sur le rapport d’expertise de sorte que celui-ci serait informé de l’exploitation qui en a été faite (envoi prévu par l’article 284-1 NCPC mais peu exécuté).
En outre, ce service pourrait :
– contribuer à l’instruction des dossiers de candidature des experts,
– élaborer un rapport de présentation de ces dossiers en fonction notamment des besoins dans telle ou telle spécialité, la pertinence des diplômes du candidat, son expérience professionnelle avérée, etc.
– centraliser toutes les informations relatives aux experts et notamment les observations des juges du fond sur les rapports d’expertise et conseiller utilement sur le choix de l’expert,
– intervenir au niveau de la commission chargée de donner son avis sur les demandes de réinscription en regard des éléments fournis ci-dessus,
– communiquer au service des expertises de la cour d’appel toutes informations utiles sur les experts.
Le magistrat chargé des expertises doit être assisté par un greffe disponible et doté des outils nécessaires adaptés à cette mission, en particulier informatiques.
Il est recommandé que :
– le service des expertises assure le suivi de toutes les expertises, sauf quand le juge s’en est réservé expressément le contrôle dans sa décision ;
– dans toutes les juridictions, il existe un véritable service des expertises, distinct du service de la cour d’appel mais coordonné avec lui, comportant au moins un juge et un greffier dédiés à cette fonction, même à temps partiel.
De la problématique des coûts et des délais
L’expert apparaît comme l’auxiliaire du juge qui contribue avec lui sous son autorité au fonctionnement de la justice.
Il est libre de conduire ses opérations expertales comme il l’entend et fait bénéficier l’institution judiciaire de ses connaissances techniques. Il doit pouvoir compter sur une juste rémunération de son travail pour autant qu’il rende compte scrupuleusement de ses investigations et réponde utilement aux questions qui lui sont posées dans les délais qui lui sont impartis et dans une enveloppe budgétaire encadrée.
Toute la problématique réside en réalité dans la maîtrise des opérations expertales dans la durée et dans le coût sans qu’il y ait lieu de faire un sort différent quant au mode de saisine du juge (référé ou procédure au fond) :
– dans la durée, car l’expertise ne doit pas être un frein ou un poids trop lourd dans le déroulement du procès,
– dans le coût, car le poids financier de l’expertise ne doit pas peser trop fortement sur l’intérêt du litige.
Depuis la mise en application au début de l’année 2006 des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les gestionnaires de fonds publics que sont les magistrats prescripteurs de frais de justice se sont attachés « à mieux dépenser », notamment en limitant au strict nécessaire la durée des investigations pénales, en contrôlant avec rigueur le déroulement de ces investigations, et en cherchant à obtenir un coût raisonnable grâce à la mise en concurrence des prestataires potentiels. Certes, l’expertise judiciaire civile ne met que marginalement en cause les fonds publics. Cependant, pourquoi le juge, soucieux de l’utilisation des deniers publics, n’aurait-il pas une pratique aussi rigoureuse lorsqu’il s’agit des fonds des justiciables ? Est-il alors concevable de retenir les règles applicables aux marchés publics, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des expertises répétitives ? De même est-il envisageable, pour les expertises complexes et coûteuses, de pratiquer une mise en concurrence ?
Les juridictions ont élaboré au cours du temps des « bonnes pratiques » qui sont destinées essentiellement à améliorer le fonctionnement de l’institution dans le souci de ne pas alourdir la charge financière du procès.
II – Réponses aux questions :
Question 1° :
Il sera répondu simultanément aux questions 1°-1 et 1°-2.
Question 1°-1 : Comment fixer le délai de l’expertise ?
Question 1°-2 : Faut-il interroger préalablement l’expert et lui demander de s’engager sur le délai de l’expertise ?
Dans le schéma simple, le juge fixera le délai par référence aux durées prévisibles selon les disciplines après une concertation générale qui pourrait s’organiser au niveau de la cour d’appel. Les délais peuvent être de l’ordre de un à six mois.
L’expérience montre qu’un grand nombre d’expertises entre dans ce schéma en particulier en matière de tutelle, de réparation du préjudice corporel, les questions relatives à la mitoyenneté et au bornage ou aux contestations sur le prix du bail commercial, l’enquête sociale…
Le jury tient à rappeler que pour la consultation, sa présentation orale (article 257, alinéa 2, NCPC) est de nature à abréger considérablement les délais et réduire les coûts.
Dans le schéma complexe, la situation est tout à fait différente et nul ne sait d’emblée quelle sera la durée prévisible de l’expertise.
Le législateur propose une manière de procéder dans ce cas résultant des dispositions de l’article 266 NCPC, qui donne la possibilité au juge de fixer une date à laquelle l’expert et les parties se présenteront devant lui (ou devant le juge chargé du contrôle) pour que soient précisés la mission et s’il y a lieu le calendrier des opérations.
Après avoir fait cette étude préalable en respectant le droit à la contradiction des parties et, au besoin, sur les lieux, puisque beaucoup d’expertises ne nécessitent pas toujours le déplacement de l’expert hors de sa salle de réunion, celui-ci adresse au juge un rapport succinct dans lequel il établit le calendrier prévisible de ses opérations. L’expert aura profité de cette première réunion pour interroger les parties sur la nature et le volume des pièces à communiquer et sera à même de vérifier en leur présence l’importance des opérations expertales, le niveau technique requis, l’éventuel recours à un ou plusieurs sapiteurs. Les parties, à ce stade, doivent être en mesure de se rendre compte de la nécessité de nouvelles mises en cause, ce qui permettra à l’expert d’évaluer les délais supplémentaires prévisibles.
Au vu de cette information écrite, le juge va fixer la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise. Cette façon de procéder a l’avantage de la souplesse. Elle implique l’expert qui aura défini lui-même la date limite du dépôt du rapport d’expertise en la soumettant à la contradiction des parties.
Il sera toujours possible par la suite dans le cas où des événements imprévisibles interviendraient contrariant le calendrier des opérations, de solliciter du juge une prolongation de délai.
Il est de bonne pratique, dans le schéma simplifié, y compris la consultation, que le juge, souvent aidé par la référence à une mission-type, fixe le délai de dépôt du rapport en se fondant sur les durées prévisibles selon les disciplines fournies par le service des expertises. Ce délai est généralement compris dans une fourchette de un à quatre mois et ne devrait pas être supérieur à six mois.
Il est de bonne pratique, dans le schéma complexe, que le juge demande à l’expert choisi de se transporter, si besoin est, sur les lieux où doivent se dérouler les opérations expertales afin de faire, en respectant le principe de la contradiction, une évaluation des difficultés prévisibles et de lui proposer un calendrier de ses opérations, et par là-même, le délai qu’il souhaite voir fixer pour le dépôt de son rapport.
Le délai de consignation
Une attention particulière doit être accordée au délai de consignation, c’est-à-dire le temps écoulé entre la décision et l’avis de la consignation à l’expert. Ce délai est parfois très long. Dans ce domaine, le juge doit être particulièrement vigilant : il appartient au greffe d’avertir l’expert de sa désignation sans attendre l’expiration du délai de consignation. Mais le technicien ne doit pas commencer ses diligences avant d’être averti de la consignation, sauf injonction du juge d’entreprendre immédiatement ses opérations, ainsi que le prévoit l’article 267 NCPC.
Rien n’empêche le juge, sur le fondement des articles 269 et 270 NCPC, de faire consigner à l’audience le montant de la provision.
Un contrôle rigoureux de cette phase de la mesure d’instruction devrait permettre de réduire considérablement sa durée d’exécution.
Il est de bonne pratique, dans le schéma simplifié, que le juge, fasse consigner à l’audience, lorsque c’est possible, le montant de la provision.
Il est de bonne pratique, dans le schéma complexe, que le juge fasse consigner à l’audience, lorsque c’est possible, un montant suffisant pour couvrir la rémunération d’une première étape de l’expertise destinée à évaluer, le contour de la mission, les délais et les coûts de l’expertise complète.
Question 2° : Le juge peut-il laisser les parties contractualiser le délai de l’expertise en concertation avec l’expert ?
Question 6° : Le juge peut-il laisser contractualiser le coût de l’expertise entre les parties et l’expert ?
Les deux questions sont ici regroupées pour être examinées ensemble.
Les observations relatives à la « contractualisation » du délai et du coût de l’expertise sont communes à celles déjà exposées dans le groupe de travail n° 3 concernant la mission de l’expert.
En cette matière comme ailleurs, une contractualisation au sens propre est incompatible avec l’imperium du juge. Toutefois, on pourra employer le terme « contractualisation » pour signifier l’accord de toutes les parties prenantes après concertation, en marquer le caractère contraignant pour les parties et les techniciens, sous les réserves d’usage.
La manière de procéder inspirée de l’article 266 NCPC et précédemment développée peut utilement, dans les expertises complexes, résoudre dans la souplesse la double question du délai et du coût de l’expertise. Il est souhaitable en effet que dans ce type d’affaires, le juge rende une première ordonnance par laquelle l’expert désigné est nanti d’une mission qui comporte in fine l’obligation de se transporter, si besoin, sur les lieux pour, en respectant le principe de la contradiction et dans le délai fixé par le juge qui est nécessairement court (un à deux mois), proposer un calendrier circonstancié et un devis détaillé du coût prévisible des opérations expertales. Ainsi l’expert qui a une connaissance précise des opérations qu’il doit conduire dans un délai qu’il a déterminé après l’avoir soumis à la contradiction des parties en tenant compte de leurs propres disponibilités est en mesure d’évaluer dans le même moment le montant prévisible de sa rémunération. Il doit même en profiter pour donner aux parties la liste des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
On peut envisager une autre forme de « contractualisation », celle des honoraires et frais.
En effet, d’autres formes de « contractualisation » ont été relevées, en particulier une « négociation collective annuelle », entre les compagnies d’experts et les services des cours d’appel ou de la Cour de cassation, portant sur le mode de facturation au temps passé et sur le montant des « taux horaires » indicatifs, séparant les honoraires et les frais applicables par les experts jusqu’à nouvelle « contractualisation ».
Cette pratique a été jugée régulière dans la mesure où elle reste indicative et ne fait pas obstacle à une éventuelle discussion, en fonction du cas d’espèce.
Cette pratique donne satisfaction dans une grande partie des cas, car elle facilite l’évaluation des coûts puis leur contrôle. Elle ne doit pas faire obstacle, néanmoins, à la forfaitisation des coûts quand celle-ci apparaît opportune, par exemple pour certaines missions-types, ou, à l’inverse, à une justification des coûts détaillée dans des cas particuliers, complexes, ou exceptionnels.
Il est de bonne pratique que dans les affaires complexes le juge demande à l’expert d’examiner les termes et conditions de l’affaire en les soumettant à la contradiction des parties afin de proposer un calendrier des opérations et d’évaluer le montant de sa rémunération. Ces éléments vont permettre au juge de l’espèce ou au juge chargé du contrôle de l’expertise de rendre une ordonnance complémentaire fixant la durée et le coût de l’expertise.
Dans les deux schémas, simple et complexe, le juge conserve la maîtrise des opérations. Néanmoins, lorsque la concertation entre l’expert et les parties sur les coûts et délais aboutit à une position commune, celle-ci constitue aux yeux du juge un engagement moral qui justifiera de sa part une vigilance accrue quant au respect des délais et coûts antérieurement acceptés.
C’est l’expert, sous le contrôle du juge, qui fixe le déroulement dans le temps de sa mission. Il ne s’agit donc pas d’une contractualisation ; cela étant, l’expert est tenu, dans tous les aspects de sa mission, au respect du principe de la contradiction, aux délais et à la motivation des choix qu’il opère. Réciproquement, les parties se doivent de faire en sorte que les conditions de délai soient respectées, en fournissant les pièces demandées et en répondant aux convocations aux opérations d’expertise.
En ce qui concerne les expertises simples, la question du coût ne se pose pas puisqu’il est possible de le forfaitiser à l’avance en concertation avec le juge chargé du contrôle ou avec la cour d’appel, sous l’autorité du premier président.
En ce qui concerne les expertises complexes, le juge veille à fixer le montant de la provision complémentaire en fonction de l’étude préalable, à laquelle l’expert se sera livré, des opérations dont il aura la charge, en respectant le droit de contradiction des parties.
Il est de bonne pratique, dans le schéma complexe, d’introduire dans l’ordonnance initiale le chef de dispositif suivant :
« Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge de l’espèce, ou au juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport. »
Question 3° : Comment, et quand, le juge procède-t-il au contrôle des délais ?
Le juge, qui a la maîtrise des opérations expertales, se doit d’assurer un contrôle effectif et efficace du délai imparti à l’expert.
L’allongement des délais constitue un problème majeur pour les expertises complexes. Il est aggravé par l’extrême technicité de certaines expertises, ainsi que par le faible nombre d’experts susceptible d’intervenir. Les parties elles-mêmes, engagées dans leurs stratégies procédurales, et les risques d’extensions successives en conséquence, contribuent aussi à l’aggravation de cette situation.
Il est permis d’espérer que pour les expertises complexes, celles qui engendrent les délais les plus longs, le mode opératoire suggéré dans les développements antérieurs aura suffisamment responsabilisé l’expert et les parties pour que les délais soient respectés ou qu’en tout cas l’expert rende compte scrupuleusement au juge des difficultés éventuelles qu’il rencontre pour solliciter son intervention.
Une procédure d’alerte, avec édition automatique par le greffe de lettres de rappel adressées à l’expert, existe dans plusieurs juridictions ; elle doit être améliorée puis généralisée.
Il est indispensable par ailleurs que le juge réagisse dans le meilleur délai en cas d’incident qui lui est signalé par l’expert ou par les parties (défaut de communication de pièces, comportement de l’expert, animosité entre l’expert et l’un des avocats, etc.) ou en cas de difficultés rencontrées par l’expert par exemple dans l’interprétation de sa mission, l’opportunité d’entendre un tiers, etc.
Il est recommandé de mettre en place un véritable système de contrôle centralisé des opérations liées à l’expertise avec à sa tête un magistrat et un greffe disponible et spécialisé, dotés d’un système informatique performant et qui sera chargé de veiller au respect des délais notamment par des relances.
Question 4° : Le juge doit-il fixer la provision en relation avec l’expert et les parties ? Quand doit-t-il la fixer ?
Les deux questions sont examinées simultanément.
Le développement suivant précise les recommandations concernant la consignation initiale vue plus haut.
Ici encore, la distinction entre le schéma simplifié et le schéma complexe sera éclairante.
Dans le schéma simplifié, le juge fixe le montant de la provision initiale au moment où il ordonne l’expertise. Compte tenu de la possibilité, dans ce type d’expertises, d’une forfaitisation, le juge fixe en réalité le montant de la rémunération définitive de l’expert. C’est le cas en matière d’expertise médicale sur l’évaluation du préjudice corporel ou sur la recherche de paternité (examen sanguin et ADN) ou bien encore pour les expertises dites obligatoires (évaluation du loyer commercial, etc.).
Il convient d’indiquer que, s’agissant de la consultation et de la constatation, le juge demande à la partie consignataire de verser la provision directement au technicien désigné sans passer par la régie de la juridiction, en application, suivant le cas, des dispositions de l’article 258 ou de l’article 251 NCPC.
Pour harmoniser les pratiques judiciaires et pour donner aux parties une meilleure lisibilité des enjeux financiers de l’expertise qu’elles sollicitent, la communication périodique de données chiffrées, improprement appelées « barèmes indicatifs », coordonnées entre les cours d’appel, à l’initiative des premiers présidents, apparaît souhaitable pour cette catégorie d’expertises.
Même s’il n’est pas possible de forfaitiser totalement ce type d’expertises, il faut relever que dans les faits, le juge qui a une pratique régulière et de l’expérience (spécialement en référé) est en mesure, pour telle ou telle catégorie d’expertise concernée d’estimer la fourchette applicable quant au montant prévisible compte tenu de la nature et des difficultés de la mission. L’article 269 NCPC l’invite à fixer un montant aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible. Pour éviter toute perte de temps provoquée par des demandes de provisions complémentaires liées à de mauvaises évaluations initiales, celles-ci devaient être égales au moins à 80 % de la valeur finale et, si possible, à la totalité de la rémunération envisagée.
La pratique montre que bien souvent les juges fixent des montants de provisions trop modestes par rapport à l’importance des diligences qui devront être engagées par l’expert. D’où les difficultés au moment de fixer la rémunération définitive.
On peut penser que ces difficultés seraient en grande partie résolues si le service des expertises fournissait en temps utile et de façon aisément accessibles les données nécessaires.
Dans le schéma complexe, ces expertises sont, par nature, plus aléatoires compte tenu notamment des enjeux techniques et, éventuellement, du nombre des parties.
On a vu que dans le système proposé qui s’inspire des dispositions de l’article 266 NCPC, le juge, en désignant l’expert, lui demande non seulement de dresser un calendrier des opérations d’expertise mais également d’établir le budget détaillé de ses opérations.
Dans cette première phase, le juge fixe le montant d’une provision initiale qui permet à l’expert d’être assuré que, pour cette phase d’évaluation, il sera dédommagé des frais qu’il va engager à cette occasion (les parties peuvent en effet renoncer à poursuivre les opérations).
Dans la seconde phase, sur la suggestion de l’expert, le juge va fixer le montant d’une provision complémentaire qui se rapprochera au mieux de la rémunération définitive. Ainsi, les parties seront informées à l’avance du probable coût final de l’expertise.
Au regard du montant de la provision complémentaire, certaines parties peuvent revoir leur stratégie initiale ou rechercher un accord. Dans ce cas de figure et à défaut de consignation complémentaire, l’expert déposera son rapport en l’état et demandera au juge le paiement de ses honoraires et frais déjà exposés, par prélèvement sur le montant de la provision initiale.
Concernant les ordonnances communes, le juge doit veiller à indiquer précisément à qui incombera le paiement de la provision complémentaire induite par l’extension de la mission de l’expert. La question des mises en cause tardives se pose réellement dans la pratique car elles retardent considérablement les opérations.
Le juge doit se montrer à cet égard particulièrement vigilant lorsqu’elles s’avèrent purement dilatoires.
Il est de bonne pratique pour le juge de fixer dès la décision initiale (expertises simples), ou à l’issue de la première réunion d’expertise (expertises complexes), le montant le plus proche possible de la rémunération définitive prévisible de l’expert.
Il est de bonne pratique, pour les expertises complexes, que dès la décision initiale, le juge fixe une provision suffisante pour couvrir les honoraires et frais de l’expert jusqu’à la décision complémentaire.
Question 5° : Dans quel cas le juge doit-il lancer un appel d’offres sur le coût de l’expertise ?
Il a été préféré l’expression de « mise en concurrence » à celle de « appel d’offres » qui est employée dans le cas des marchés publics de l’Etat et qui ne s’applique pas en l’occurrence, dans les procédures civiles.
Il n’en reste pas moins que l’autorité judiciaire a le devoir de prendre en compte l’intérêt des justiciables et qu’elle se doit d’utiliser pour ce faire les meilleures pratiques en cette matière. Les nouvelles habitudes créées par la mise en œuvre de la LOLF dans les cours d’appel, bien qu’elles aient trait à la gestion de la dépense publique, vont dans le même sens d’une gestion conforme aux principes économiques généraux.
La mise en concurrence, dans les cas simples, ne peut à l’évidence pas avoir lieu à l’audience, puisque la décision doit être prise en une fois et avec le minimum de procédure ; ne doit-elle pas être organisée en amont par le service des expertises ? Dans les cas complexes, le juge de l’espèce et le juge du contrôle peuvent-ils ensemble, avec l’aide du service des expertises, organiser une mise en concurrence ?
Il apparaît au jury que si le juge de l’espèce, qui doit gérer l’expertise au meilleur coût, a peu de moyens pour organiser une telle mise en concurrence (ex. : expertises génétiques), l’institution devrait être en capacité de gérer cette dépense au mieux des intérêts des justiciables et de l’ordre public.
Le juge ne dispose pas en l’état des moyens lui permettant d’effectuer une mise en concurrence. Dès lors, il est de bonne pratique que le juge demande, s’il le souhaite, au service des expertises de lui indiquer un nom, ou une liste d’experts, pouvant effectuer la mesure d’instruction en question.
Dans le cas des expertises simples et normalisées, une mise en concurrence au niveau de la cour d’appel pourrait être envisagée, avec toutes les précautions d’usage compte tenu du principe du libre choix de l’expert par le juge.
Question 7° : Le juge doit-il informer les parties des règles relatives à la charge définitive du coût de l’expertise, et des règles relatives à la liquidation des dépens en cas d’aide juridictionnelle ?
Dans les procédures avec représentation obligatoire l’information est supposée correctement assurée par le conseil auprès de son client que ce dernier soit ou non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou partielle.
Par contre il n’en va pas de même dans les procédures sans représentation obligatoire ou les parties peuvent comparaître en personne (tribunal d’instance, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce, ….).
Quoi qu’il en soit, cette information doit être faite le plus en amont possible de la décision d’expertise (au besoin verbalement à l’audience) parce que l’information complète sur la charge finale du coût de l’expertise et les incidences de l’aide juridictionnelle sont de nature à influer sur la décision des parties de maintenir ou non leur demande de mesure d’instruction.
On recommandera donc une formule insérée dans la décision ordonnant l’expertise laquelle fixe le délai, le montant de la provision (forfaitaire pour l’expertise simple, complémentaire pour l’expertise complexe) ainsi que l’information sur la charge définitive du paiement du coût de l’expertise en particulier en matière d’aide juridictionnelle.
Il ne paraît pas opportun de joindre une note rappelant les principales règles applicables en matière de recouvrement des frais.
Il importe en effet d’avoir recours à un mode simple d’information laquelle doit être présentée dans la décision qui fixe les « règles du jeu expertal ».
Il est de bonne pratique que la formule suivante soit insérée à la fin de l’ordonnance désignant l’expert et fixant le délai, le montant de la provision et la partie qui doit en faire l’avance :
« Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès. »
Et pour les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle, ajouter cette formule :
« Le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ».
______________