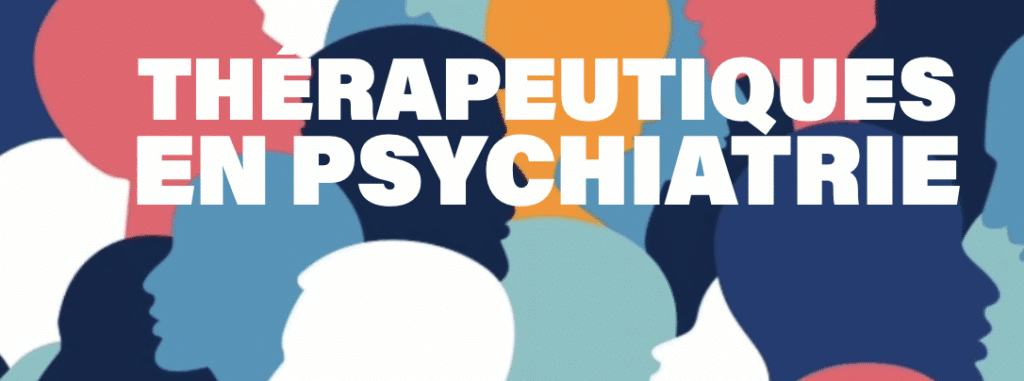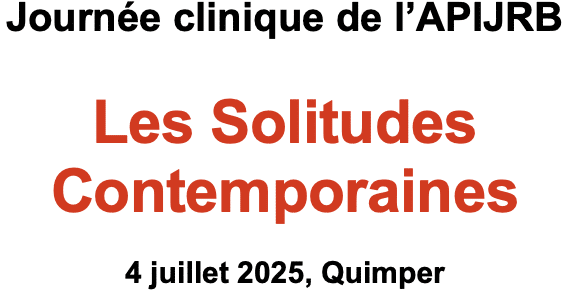Recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles
Conférence de consensus
« L’expertise judiciaire civile »
Recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles
Version longue
15-16 novembre 2007
Cour de cassation, Paris
Sommaire :
PRESENTATION DE LA CONFERENCE :
Les bonnes pratiques judiciaires : définitions et remarques liminaires
SUR LA NECESSITE DU RECOURS A L’EXPERTISE
Question 1°-1 : Quels sont factuellement les grands types d’expertise ?
Question 3° : Quelle est l’incidence du coût de l’expertise sur la décision d’y recourir ?
Question 2°-1 : Peut-on, et si oui comment, choisir l’expert hors liste ?
Question 6° : Comment apprécier l’indépendance de l’expert ?
Question 6°-1 : Faut-il lui demander de faire une déclaration d’indépendance ?
Question 6°-2 : Si oui, sous quelle forme ?
Question 6°-4 : Quelle est la place respective des experts judiciaires et des experts de parties ?
SUR LA DEFINITION DE LA MISSION D’EXPERTISE
Question 1°-2 : Les parties peuvent-elles contractualiser la mission à soumettre au juge ?
Question 2°-1 : Dans quels cas le juge ne doit-il pas utiliser une mission type ?
Question 2°-2 : Faut-il modéliser les missions-types ?
Question 3°-1 : La mission peut-elle préciser la méthodologie que devra employer l’expert ?
SUR LES DELAIS ET LE COUT DE L’EXPERTISE
Question 1°-1 : Comment fixer le délai de l’expertise ?
Question 3° : Comment, et quand, le juge procède-t-il au contrôle des délais ?
Question 5° : Dans quel cas le juge doit-il lancer un appel d’offres sur le coût de l’expertise ?
AVANT-PROPOS
La Cour de cassation et la Conférence des premiers présidents de cour d’appel indiquent que les conclusions et recommandations présentées dans ce document ont été rédigées par le jury de la Conférence de consensus en toute indépendance. Elles sont proposées aux juges, sans valeur normative, pour contribuer à une meilleure qualité de la justice.
La présente « version longue » des recommandations fait l’objet d’une « version courte » qui en est la synthèse.
La synthèse du jury
Présentation du document
Les réponses aux questions posées par le promoteur à l’attention du juge constituent la première partie du document. Elles sont présentées dans l’ordre proposé par le promoteur qui les a ordonnées en quatre groupes sur :
– Sur la nécessité du recours à l’expertise,
– Sur le choix de l’expert,
– Sur la définition de la mission de l’expertise,
– Sur les délais et le coût de l’expertise.
Pour chaque groupe de questions, à l’exception du troisième, une présentation synthétique, renvoyant aux documents de référence, précède les recommandations elles aussi synthétiques.
Dans de nombreux cas, il est apparu dans les groupes de travail que des mesures d’organisation et d’administration judiciaires étaient utiles voire nécessaires pour faciliter les bonnes pratiques retenues en réponses aux questions : le jury a fait sienne cette volonté de ne pas limiter ses recommandations au cadre existant.
Ce sont principalement des regroupements de moyens dépendant de l’administration judiciaire, dans les juridictions, les cours d’appel, ou à des niveaux géographiques plus larges, sur lesquelles le juge pourrait s’appuyer. Citons à titre d’exemple une référence fréquente au « service du contrôle des expertises» de la cour d’appel ou des grandes juridictions.
Ce sont aussi des recommandations ou des souhaits adressés aux auxiliaires de justice, voire aux justiciables, tant à titre particulier dans leur pratique du procès, que dans leurs instances représentatives, ordinales ou associatives. Dans certains cas, même, il est apparu utile de sortir du cadre judiciaire pour mobiliser d’autres ressources comme les sociétés savantes ou les instances de normalisation et de qualification : l’expertise en effet n’est pas que judiciaire, elle est aussi une « démarche fréquemment utilisée pour élaborer des avis, des interprétations, des recommandations en vue de prévenir, d’innover, de construire et d’expliquer l’origine des événements ou des catastrophes, d’établir des responsabilités, d’éclairer la résolution des conflits, d’évaluer des dommages, des objets ou des services de toute nature » comme le définit la norme X50-110 et peut donc bénéficier de partage d’expérience ou de moyens avec les autres parties prenantes à l’expertise en général.
Les annexes et références
Afin de ne pas alourdir la présente synthèse, les textes pertinents et les documents de travail sont reproduits en annexe ou cités en référence.
Un point déterminant : s’inscrire dans la durée
Le jury souhaite que ces recommandations aident sans délai les juges, les parties et les acteurs du procès dans leur pratique quotidienne.
Il a conscience que la bonne pratique qu’il décrit est amenée à se modifier au rythme des évolutions culturelles, de l’influence du droit comparé et des possibilités technologiques, ainsi que de ses difficultés d’application.
Les bonnes pratiques judiciaires : définitions et remarques préliminaires :
Les modalités des mesures d’instruction exécutées par un technicien
L’article 232 NCPC en distingue trois :
– la constatation, qui désigne l’acte par lequel le technicien se prononce sur la matérialité de faits qu’il décrit et dont il fait rapport au demandeur (cf. article 249 NCPC) ;
– la consultation, qui désigne l’acte par lequel le technicien énonce un avis sur une question purement technique ou sur une question de l’espèce ne demandant pas d’investigation complexe (cf. article 256 NCPC) ;
– l’expertise, qui désigne l’acte par lequel le technicien énonce un avis sur une question impliquant la mise en œuvre d’investigations complexes demandant au technicien, outre des recherches dans les bases de données accessibles ou l’exploitation de sa propre expérience, des investigations particulières (cf. article 263 NCPC).
Des difficultés sémantiques
Il est courant d’employer le terme « expertise », dans le contexte judiciaire, au sens large de « mesure d’instruction confiée à un technicien », alors que l’expertise n’est que l’une des modalités de ces mesures d’instruction, la plus intensive et souvent la plus coûteuse.
Or, ce glissement sémantique peut être dommageable en ce qu’il conduit la pratique judiciaire à négliger les autres modalités et à recourir trop mécaniquement à l’expertise.
Il est de bonne pratique de bien distinguer les différentes modalités d’instruction confiées à des techniciens et d’utiliser les appellations exactes.
Dans le présent document, le terme d’expertise a été le plus souvent utilisé au sens large.
La référence au « juge »
Dans de nombreux cas, les textes font référence au « juge » : ainsi l’article 153 NCPC, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, dispose que la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge ; ainsi l’article 235 NCPC prévoit que si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Il apparaît donc que « le juge » que mentionnent les textes peut être soit le juge qui a ordonné la mesure d’instruction soit un autre juge, chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
Cette pluralité peut parfois créer difficulté, notamment aux juges eux-mêmes, ou aux parties ou au technicien, qui ignorent qui a pouvoir de statuer aux différents moments de l’exécution de la mesure d’instruction.
Le jury lui-même a souvent été confronté à cette situation. Il en a conclu que toutes les juridictions devraient organiser la fonction du « juge du contrôle » en un service structuré, doté de moyens permanents. Les « juges du contrôle » et les services de la cour d’appel ayant à connaître des experts, devraient travailler en étroite collaboration à toute étape des mesures d’instruction confiées à des techniciens : choix de l’expert, définition des missions, fixation des délais et des coûts, contrôle des opérations, notamment.
SUR LA NECESSITE DU RECOURS A L’EXPERTISE
Ce chapitre, expose, outre les développements nécessaires pour répondre aux questions du premier groupe de travail, des éléments communs aux quatre groupes.
I – Présentation synthétique :
Juger procède d’une fonction régalienne et se présente comme un pouvoir confié au juge en raison de son savoir. Mais le savoir juridique peut être insuffisant et, puisque pour juger il faut comprendre, le savoir technique doit être apporté au juge, par les parties lors de l’établissement des preuves et/ou par le recours au savoir de techniciens. L’histoire montre l’avènement progressif du recours à l’expertise et donc du recours à l’expert.
L’expertise est-elle nécessaire au règlement du litige ? Telle est la question à laquelle le juge devrait répondre à l’occasion du recours à l’expertise. Cependant, l’analyse de la pratique (A) comme celle des raisons de recourir ou non à l’expertise (B) apportent des éclairages contrastés à la réponse qui peut lui être apportée et qui peut être complétée, à la lumière du droit comparé, par l’influence des garanties fondamentales du procès (CEDH), notamment à propos du rôle des parties (C).
A – La pratique :
Recours à l’expertise ou recours au technicien
Quand recourt-on à l’expertise ? Sur quoi porte-t-elle et dans quelle perspective est-elle utilisée ? Est-elle distinguée des procédés voisins ?
Selon les dispositions applicables, la finalité des mesures d’instruction faisant appel à un technicien consiste soit à établir la matérialité de certains éléments de preuve, soit à déterminer l’existence de faits propres à constituer autant de maillons utilisés dans le raisonnement du juge, soit encore à prolonger une première décision du juge en chiffrant ses conséquences, contribuant ainsi à l’achèvement de la décision judiciaire.
La pratique du recours à l’expertise dépasse donc par son ampleur celle qui résulte de la lettre des textes (articles 144, 147 et 263 NCPC) : c’est-à-dire établir la preuve, ou la conservation de faits pour éclairer le juge sur une question factuelle, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Parmi l’éventail des recours aux techniciens prévus par le Code civil, c’est surtout à l’expertise que la pratique recourt, sans respecter la gradation prévue par les textes entre l’enquête, la constatation, la consultation et l’expertise et, a fortiori, sans utiliser les possibilités de transport sur les lieux et de constatation personnelle. Il y a donc une nette distorsion entre la variété des mesures d’instructions disponibles et celle massivement utilisée : l’expertise.
La conférence insiste sur le respect des textes : le principe du recours à une mesure d’instruction doit être limité aux cas dans lesquels celle-ci est non seulement utile, mais nécessaire à la solution du litige.
S’agissant du choix de la mesure d’instruction, un glissement sémantique s’est opéré par rapport aux termes employés dans le nouveau code de procédure civile. Là où les textes envisagent de façon générique un technicien dont l’expert n’est qu’une espèce aux côtés du constatant et du consultant, la pratique utilise le terme « expert » comme synonyme de technicien, ce qui contribue à généraliser le recours à l’expertise au détriment des autres mesures d’instruction.
Il est de bonne pratique d’adapter le choix du technicien au but recherché et notamment à la complexité des investigations envisagées. Il convient aussi, s’agissant du référé probatoire, de vérifier non seulement la légitimité de la mesure demandée mais aussi son objet, c’est-à-dire sa limitation à l’établissement, ou à la conservation, des preuves.
En effet, le recours à l’expertise intervient surtout avant tout procès (60 à 80% des cas). Elle est aussi ordonnée par le juge de la mise en état ou lorsque l’affaire est plaidée. Le jury constate, en l’absence de données statistiques exploitables, qu’il ne dispose pas d’une image fidèle de la répartition des domaines dans lesquels les expertises sont ordonnées. Il résulte cependant d’une enquête partielle que les principaux domaines sont ceux du bâtiment et de la santé.
B – Les raisons de recourir ou non à « l’expertise » :
Le cas général et les exceptions
Le juge est libre de décider de recourir à l’expertise ; ce principe du droit français est également commun à d’autres droits du système romano-germanique, comme le droit italien ou le droit allemand. Cette liberté s’affirme particulièrement au cours de l’instance. Certains éléments contribuent pourtant à dissuader le juge tandis que d’autres au contraire l’incitent ou l’y obligent.
L’obligation qu’a parfois le juge de recourir à l’expertise trouve sa source dans les textes : plutôt qu’une expertise judiciaire, il s’agit d’une expertise légale. Le législateur peut en effet présumer que le juge ne dispose pas des connaissances suffisantes (par exemple en matière de filiation, sauf preuve d’un motif légitime de ne pas y recourir, ou en matière d’action en rescision pour lésion, article 1678 C. civ.).
La dissuasion découle de considérations techniques ou financières.
S’agissant des considérations techniques, le juge refuse de recourir à l’expertise dans diverses hypothèses. Il peut d’abord se considérer assez éclairé (par exemple parce qu’ont été claires et non véritablement remises en cause les « expertises amiables », c’est-à-dire les avis ou recommandations de techniciens donnés à la demande d’une ou des parties, versés au débat ; cela peur résulter ensuite de son expérience, tirée de litiges similaires, ou enfin des prétentions du demandeur manquant de pertinence, insuffisamment caractérisées ou vouées à l’échec.
Les considérations financières sont plus présentes pour les parties ou leurs conseils qu’elles ne le sont pour le juge qui ne sait pas toujours si telle partie bénéficie ou non d’une protection juridique. La Conférence estime que la décision de recourir à une mesure d’instruction ne devrait pas résulter de la question de savoir qui en supportera le coût. Cependant, outre certains domaines (droit de la filiation par exemple) dans lesquels les considérations financières n’interviennent pas en raison de l’obligation imposée par le législateur de recourir à l’expertise ou de la difficulté particulière de la question, le juge aura parfois le sentiment que l’expertise n’est pas utile et surtout disproportionnée par rapport à l’enjeu, surtout s’il est saisi de litiges aux montants modestes.
L’incitation ne peut que résulter d’une stricte application des textes et en aucun cas elle ne saurait résulter d’une volonté, consciente ou non, de confier, fût-ce indirectement, à un technicien le soin de trancher un litige.
En particulier, pour ce qui est des mesures d’instructions ordonnées en référé au visa de l’article 145 NCPC, même si la jurisprudence n’applique pas de façon rigoureuse la condition prescrite par l’article 146 NCPC, on ne doit pas en conclure qu’il pourrait être ordonné des mesures d’instruction sans lien avec la nécessité d’obtenir ou de conserver une preuve.
C – L’incidence des garanties fondamentales du procès :
La conférence attire l’attention sur le fait que les mesures d’instruction ne sont pas exclusivement régies par les dispositions du nouveau code de procédure civile et qu’il convient de prendre en compte les garanties fondamentales du procès équitable pour autant que leur application s’impose.
La Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas encore complètement investi l’expertise, envisagée de manière autonome mais, parce que l’expertise se déroule sous l’autorité du juge, elle lui applique certaines des règles du procès équitable.
Il est d’ailleurs à noter que la CEDH emploie le terme « expertise » au sens large d’intervention d’un technicien au procès, même en dehors du cadre des mesures d’instruction prévues par le NCPC en France.
Cela ne modifie pas profondément les conditions du recours à l’expertise (par exemple la norme de l’indépendance et de l’impartialité de l’expert), mais l’incidence est plus grande s’agissant des modalités du recours (la durée raisonnable, le principe de la contradiction et l’égalité des armes) appliquées à l’expertise : elle diminue la liberté du juge (cf. par exemple, CEDH 8 mars 1997, Mantovanelli c/. France, Rec. 1997, II, p. 436).
Il ne semble pas toutefois que la Cour européenne des droits de l’Homme ait jamais considéré qu’il existe un droit des parties à faire nommer un expert par le juge ; inversement, il ne semble pas non plus que le juge soit obligé de consulter les parties avant de nommer un expert.
Toutefois, afin de rapprocher les pratiques romano-germaniques et anglo-saxonnes, la conférence considère qu’il serait opportun que soit instauré un débat contradictoire. En effet, les droits de Common Law ne connaissent guère l’expertise judiciaire au sens d’expert nommé par le juge, malgré une évolution récente dans ce sens. En Common Law, ce sont généralement les parties qui nomment leurs experts ; le juge a pour mission, d’inciter les parties à avoir recours à un seul expert ou de les autoriser les parties à recourir à « leur » expert en vérifiant l’absence d’abus puis en contrôlant la discussion contradictoire sur leurs rapports, y compris devant lui.
La réponse :
En définitive, à la question l’expertise est-elle nécessaire à la solution du litige ?, c’est encore le juge qui répond, même si le législateur peut parfois la lui imposer, et si la demande des parties le conduit à en faire débattre contradictoirement, sans pour autant qu’elles partagent ce pouvoir.
II – Réponses aux questions :
Question 1°-1 : Quels sont factuellement les grands types d’expertise ?
Les expertises pourraient être classées selon plusieurs distinctions : par exemple, celle de la procédure utilisée (référés, requêtes, mise en état, au fond), celle de la matière traitée (bâtiment, santé, comptabilité-finance), celle de la nature juridique du litige (responsabilité, contrats, droit de la famille), ou encore celle de la finalité (recherche de preuve du fait, recherche des fautes professionnelles, chiffrage des conséquences). Mais ces classements sont peu opérants, sauf pour le choix du technicien retenu en l’espèce (groupe 2) et la recherche éventuelle d’une mission-type (groupe 3).
Aussi, en pratique, trois critères seront retenus :
Critère Obligation/incitation/dissuasion
L’obligation est prévue par un texte ou son interprétation jurisprudentielle (cf. annexe, les cas d’expertise obligatoire pour le juge). La dissuasion résulte de l’illégitimité de la demande (notamment s’il s’agit de pallier la carence d’une partie), de son caractère dilatoire, obstructif ou tardif – lorsqu’il s’agit d’appeler une nouvelle partie en intervention forcée -, ou encore de la disproportion entre son coût et la valeur de la demande (proportionnalité). L’incitation résulte, dans tous les autres cas, de la volonté du juge de prendre en considération la volonté des parties demanderesses, encouragée par la convergence avec les règles de Common law, de l’évolution de la pratique de « contractualisation », et des possibilités de conférence ouvertes notamment par les articles 266 et 764 NCPC.
Critère de complexité
Ce critère est utile à de nombreux stades de l’intervention du technicien, quoique les textes ne le définissent pas. La complexité peut tenir notamment au caractère de principe de la question à trancher, à la nature et à l’importance des investigations à réaliser, au nombre de parties en cause, ou encore à l’enjeu du litige.
On peut, d’ailleurs, en respectant ces critères, donner une liste, non limitative, de domaines pour lesquels les expertises ne sont pas complexes même si elles peuvent être délicates, sauf cas d’espèces : expertise de mise sous tutelle, de réparation du préjudice corporel, questions relatives à la mitoyenneté et au bornage, contestations sur le prix du bail commercial, enquête sociale, interprétariat, traductions.
Critère de proportionnalité
Ce critère tend à faire respecter le principe du « bon sens » et propose qu’une mesure soit considérée comme injustifiée si son coût est disproportionné ou s’il ne peut pas être invoqué un intérêt supérieur mettant la demande au-dessus de toute valorisation économique (ce qui pourrait par exemple être invoqué dans le cas de l’expertise demandée dans l’intérêt d’une personne vulnérable subissant une souffrance morale).
Il est de b