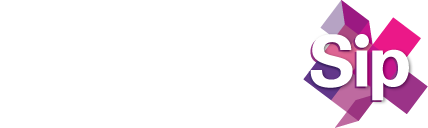La psychiatrie est concernée par la loi du 15 aout 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, souvent résumée sous la formule simplifiée « réforme pénale ». Il s’agit d’avancées à petits pas, plutôt timides, mais peut-on faire mieux dans ce monde pusillanime où les responsables politiques n’osent guère prendre des décisions risquant de déclencher des tempêtes politico-médiatique pouvant obérer leur avenir électoral. Ainsi, il aurait été courageux d’abroger la rétention de sûreté. Son report a été habilement (mais plutôt fallacieusement) négocié en arguant que la présente loi traitait des délits et non des crimes. Pourtant, les points de réforme concernant la responsabilité pénale ont aussi un rapport avec les crimes. Ils ont été enfin abordés, mais toujours timidement. Il en est de même pour la suspension de peine pour raison médicale (qui peut aussi concerner des personnes condamnées pour des crimes).
1. La modification de l’article 122-1 alinéa 2 relative à l’altération du discernement (article 17 de la loi)
Après plusieurs tentatives parlementaires, l’altération du discernement est mieux prise en compte avec une réduction du tiers du quantum de la peine en cas de privation de liberté. Toutefois, les personnes condamnées à la réclusion criminelle ou à la détention criminelle à perpétuité voient leur peine ramenée à… 30 ans. En matière correctionnelle, la juridiction en motivant sa décision peut ne pas appliquer la diminution de peine. Dans la nouvelle rédaction de l’article 122-1 alinéa 2 (Tableau 1), apparaît une formulation que nous allons retrouver à quatre reprises dans le texte de loi et qui pose un sérieux problème : « avis médical ». En effet, la juridiction doit s’assurer que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état après « avis médical ». Il aurait été préférable qu’il soit fait état d’une expertise médicale. Je reviendrai sur cette particularité ultérieurement. Mais d’ores et déjà, on peut s’interroger sur les moyens qu’aura la juridiction pour s’assurer précisément des modalités d’exécution de la peine relativement aux besoins sanitaires.
Cette timide avancée dans la prise en compte des troubles mentaux pour fixer la peine privative de liberté devra probablement être couplée avec les possibilités ouvertes par la suspension de peine pour raison médicale.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état»
Tableau 1. Nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article 122-1 du code pénal (modifications en gras)
2. Le juge de l’application des peines et l’altération du discernement (article 17 de la loi)
Si une personne reconnue comme ayant une altération de son discernement n’a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire (pouvant comporter une injonction de soins), le JAP peut ordonner une obligation de soins allant jusqu’à 10 ans si l’état de la personne le justifie et après « avis médical » (encore) selon l’article 706-136-1 du code de procédure pénale.
Il est également prévu (article 721 CPP) que le JAP retire les réductions de peines lorsque la personne condamnée refuse les soins proposés et après « avis médical » (qui sera demandé évidement au psychiatre de la prison… et non à un expert). Idem pour les réductions de peine supplémentaires (article 721-1) et toujours après « avis médical ». La référence à l’avis médical, et non à une expertise médicale, a souvent été dénoncée par quelques psychiatres exerçant en milieu pénitentiaire (mais pas par tous). En effet, l’article 721 du code de procédure pénale, relatif au crédit de réduction de peine y fit déjà référence (Tableau 2). Ce texte montre les chausse-trappes qui attendent les médecins exerçant en prison et qu’il convient une fois de plus d’exposer. On remarque ainsi que le JAP est informé que le condamné ne suit pas le traitement de façon régulière (informé par qui ? Comment ?). D’autres articles indiquent que le suivi d’un traitement est attesté par un certificat remis au patient par le praticien (tous les trois mois) et qui le transmet ensuite à qui de droit comme bon lui semble. Ce cas de figure peut paraitre simple mais s’avère plus complexe qu’il n’y parait sans qu’il soit possible de détailler ici les difficultés rencontrées. Mais indépendamment de cette démarche, l’administration pénitentiaire dispose de moyens divers pour obtenir cette information, mais de manière parcellaire, et qu’elle ne devrait pas transmettre puisque l’article 45 de la loi pénitentiaire de 2009 affirme que « L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation ». L’expérience de l’exercice médical en prison associée à la lecture attentive d’un tel article reflète bien les contournements exercés par le législateur pour entraver un exercice médical respectueux de la confidentialité indispensable à son humble efficience mais mis en échec permanent par l’organisation panoptique pénitentiaire et judiciaire.
En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5.
Tableau 2. L’avis médical requis dans les réductions de peine (art. 721 CPP)
3. La contrainte pénale
La contrainte pénale, nouvelle peine dans l’arsenal des sanctions, devait être la grande innovation de la réforme pénale. Certains souhaitaient qu’elles remplacent la peine privative de liberté. A l’issue des âpres discussions, elle devient une option supplémentaire au catalogue des sanctions du code pénal.
La contrainte pénale (article 19 de la loi et 131-4-1 du CPP) « emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société ».
Parmi les obligations et interdictions qui accompagnent la contrainte pénale, les obligations de soins (comme dans le sursis avec mise à l’épreuve) et l’injonction de soins pourront concerner la psychiatrie et augmenter la « demande » de soins. Pour rappel, l’obligation de soin ne prévoit pas une expertise médicale préalable contrairement à l’injonction de soins pour laquelle une expertise préalable est obligatoire (et si possible cliniquement et thérapeutiquement bien argumentée).
4. La suspension de peine pour raison médicale (articles 50 et 51 de la loi)
La suspension de peine pour raison médicale est le dernier point de la réforme qui concerne la psychiatrie. Un groupe de travail avait été lancé par les ministres de la santé et de la justice fin 2012 pour faire des propositions afin d’améliorer le dispositif de la suspension de peine pour raison médicale. La suspension de peine pour raison psychiatrique n’a jamais été appliquée du fait de l’interprétation erronée d’une phrase du code de procédure pénale qui en aurait empêché l’application (Tableau 3) : « hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux ». Le groupe de travail a proposé la suppression de la phrase litigieuse sans remplacement par une autre formulation après avoir fait le constat que cette formulation n’excluait la suspension de peine que pendant l’hospitalisation en psychiatrie d’une personne condamnée.
Malheureusement, si la réforme pénale a légèrement amélioré l’accessibilité à la suspension de peine pour raison psychiatrique, le législateur qui considère toujours les malades mentaux comme dangereux a maintenu une restriction. Il convient de discuter ces changements.
Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
Tableau 3. Ancienne rédaction de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale
L’avancée majeure de la loi se trouve dans une petite précision (art. 147-1 et 720-1-1). En effet, l’accessibilité à la suspension de peine pour raison médicale concerne « l’état de santé physique ou mentale ». Un pas en avant donc, suivi d’un pas en arrière car « la mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée ». Cette nouvelle phrase litigieuse remplace la précédente. Contrairement aux projets initiaux concernant les UHSA qui devaient accueillir les patients en soins libres, en SPDT et en SPDRE, l’hospitalisation en SPDT n’est plus possible en UHSA. Si une personne est hospitalisée sans son consentement, en UHSA ou en établissement psychiatrique, c’est uniquement sous la modalité SDRE, donc impliquant la notion de dangerosité. On note bien l’illusion d’une offre de soins égalitaire pour les personnes détenues alignée sur celle du droit commun comme l’affiche hypocritement les pouvoirs publics. Un patient déprimé et suicidaire quand il ne consent pas aux soins est le plus souvent hospitalisé en SDT et non en SDRE (sauf s’il présente un danger pour l’ordre public et la sûreté des personnes en se jetant sous le train ou en voulant faire exploser son logement par exemple). Pour une personne détenue, ce ne sera que le SDRE.
Au cours du groupe de travail, il est apparu que la suspension de peine pour raison psychiatrique était possible sauf lorsque la personne était hospitalisée (et au moment de la promulgation de la loi Kouchner début 2002, les UHSA n’existaient pas et l’hospitalisation n’était possible que sous le régime de l’HO D398). C’est-à-dire que pendant tout le reste de la détention, il était possible de demander la suspension de peine. Personne ne l’a demandé (ou plutôt, s’il y eut quelques demandes, elles ont toujours refusées par les JAP en arguant que seule l’hospitalisation en psychiatrie représentait une alternative à la prison) pour plusieurs raisons plus ou moins honorables mais une assez sérieuse consistait à craindre un retour en détention si l’état de santé s’améliorait, ce qui rendait difficile de monter un projet pérenne pour la personne concernée. Sur ce point, la présente loi a montré une légère avancée (art. 729 CPP) : « Lorsque le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement de l’article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation ». Le groupe de travail avait relevé cette difficulté et suggéré un montage de ce type (mais sans préciser de délai).
Dans la nouvelle situation créée, il sera possible de demander la suspension de peine pour toutes les personnes détenues (dont la libération pour les personnes prévenues : nouvelle avancée de la loi) quand elles ne sont pas hospitalisées sans leur consentement.
On peut s’attendre à quelques difficultés car ce choix, dicté par des préoccupations sécuritaires (et non sanitaires), est finalement peu cohérent. Les personnes détenues pour lesquelles il pourrait être envisagé une suspension de peine sont celles qui présentent les pathologies les plus graves avec bien souvent un discernement qui a été considéré comme altéré. Elles font l’objet d’hospitalisations répétées le plus souvent sans leur consentement. Il sera possible de demander une suspension de peine pendant les intervalles de relative stabilisation mais la suspension de peine demandée face à un état durablement incompatible avec la détention pourrait s’accompagner d’une hospitalisation préalable et si elles refusent en SPDRE, donc rendant incompatible la suspension de peine. Idem, si la personne peut être libérée avec soit une hospitalisation en service libre soit sans hospitalisation mais avec un suivi ambulatoire, que se passera-t-il si une hospitalisation en SPDRE survient. Doit-elle être remise sous écrou pendant l’hospitalisation sous contrainte ? Les projets seront délicats à bâtir.
En fin de compte, les personnes les plus lourdement malades sur le plan psychiatrique qui devraient ne pas être incarcérées seront celles qui risqueront d’être considérées comme non éligibles à une suspension de peine. C’est bien pour éviter ce risque que le groupe de travail avait demandé qu’il n’y ait pas de différence dans la rédaction de la loi entre pathologies somatiques et psychiatriques.
Les UHSA et l’organisation à trois niveaux de la psychiatrie en milieu pénitentiaire dont l’atypique hospitalisation de jour en SMPR (niveau 2) ont encore de beaux jours devant elles en pérennisant les malades mentaux dans des prisons surpeuplées pour encore bien longtemps sauf si le secteur de psychiatrie générale retrouvait une implication forte auprès de toutes les personnes se trouvant sur sa zone (pour éviter d’utiliser le terme de territoire…) d’influence sans avoir besoin de recourir au concept de secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire .
Concernant la procédure de suspension, on remarque un allègement avec la nécessité d’une seule expertise et non plus de deux, ce qui permet d’amener une courte conclusion.
Conclusion
Sur le plan symbolique, on remarque quelques avancées au bénéfice des personnes souffrant de troubles mentaux : une possibilité de réduction du quantum de la peine (mais non systématique) pour celles dont l’altération du discernement a été retenue et une petite clarification pour l’accès à la suspension de peine pour raison psychiatrique.
Mais le risque est grand de voir les psychiatres exerçant en prison devenir des auxiliaires de justice au détriment d’experts en voie d’extinction comme le montre le recours à « l’avis médical ». La nécessité d’avoir une seule expertise au lieu de deux lors de la procédure pour suspension de peine pour raison médicale va dans le sens d’une simplification mais indirectement prend en compte la diminution du nombre d’experts. Par ailleurs, la chancellerie travaille à une simplification des procédures nécessitant des expertises psychiatriques. Moins d’expertises prend en compte l’extinction du corps des experts, qui risque d’aller en s’accélérant du fait de nouvelles et complexes contraintes administrativo-fiscales qui pèsent sur cet exercice professionnel, et des économies financières qui en résulteront.
Il s’agira alors de demander des avis médicaux (gratuits) aux psychiatres exerçant en prison permettant ainsi la mise en place d’une psychiatrie pénitentiaire et judiciaire , éloignée du soin mais exclusivement dédiée au parcours d’exécution des peines, suivant en cela les dispositions de ces dernières années comme la création des commissions pluridisciplinaires uniques qui se tiennent dans les prisons, avec mission d’étudier le parcours d’exécution des peines des personnes condamnées et à laquelle les soignants sont conviés avec insistance, faisant fi des obligations inhérentes au secret médical et à la confidentialité des soins qui, comme les experts psychiatres, deviennent des règles éthiques en voie de disparition et pas uniquement en prison .
On croyait la médecine pénitentiaire (une médecine de sous-hommes disait Robert Badinter ) abolie avec la loi de 1994 mais revoilà la psychiatrie pénitentiaire.